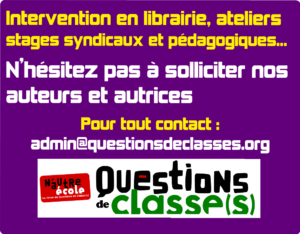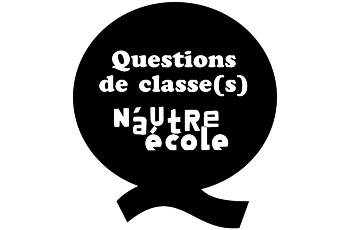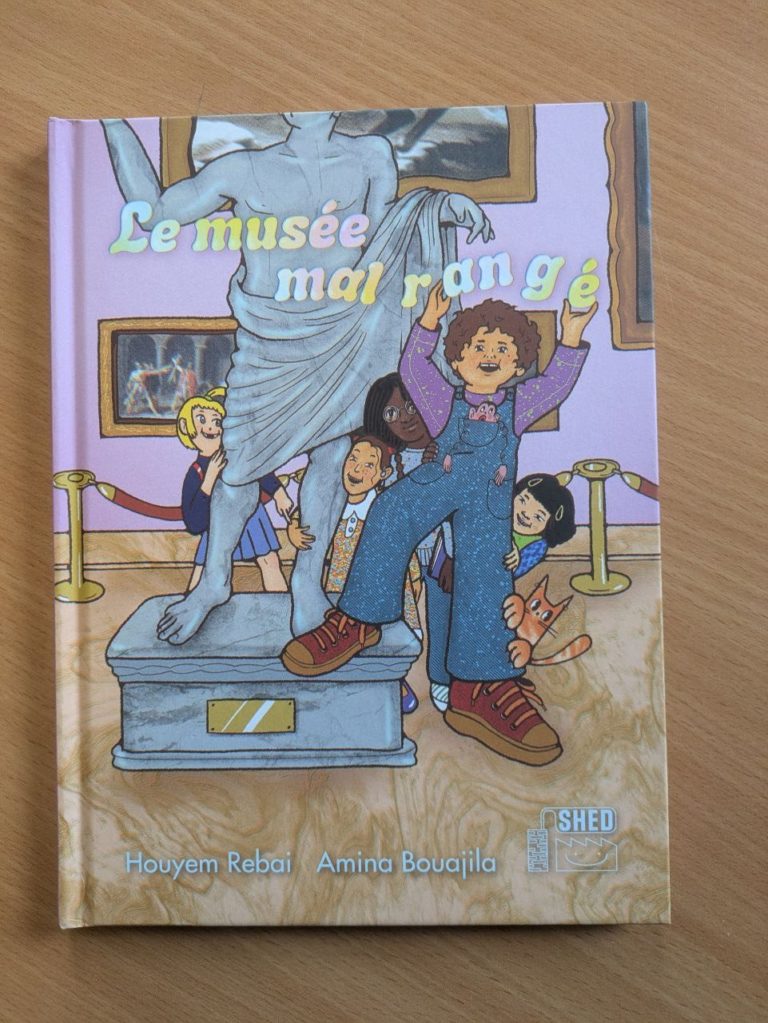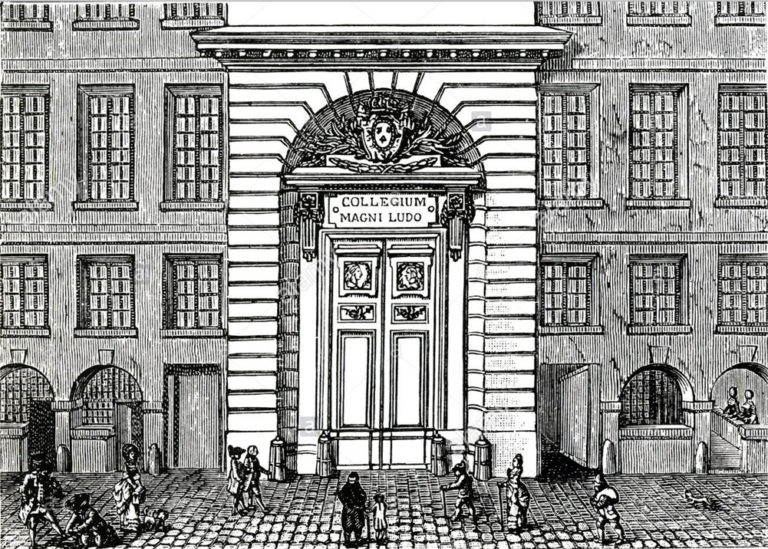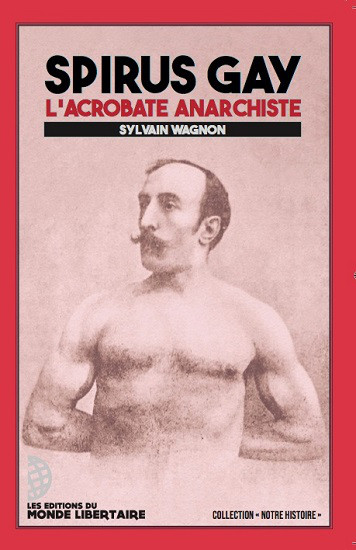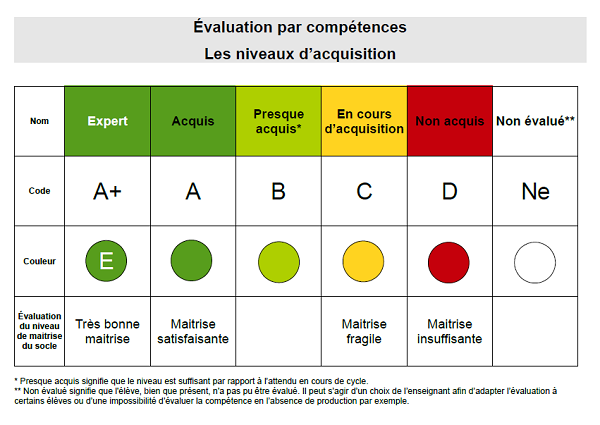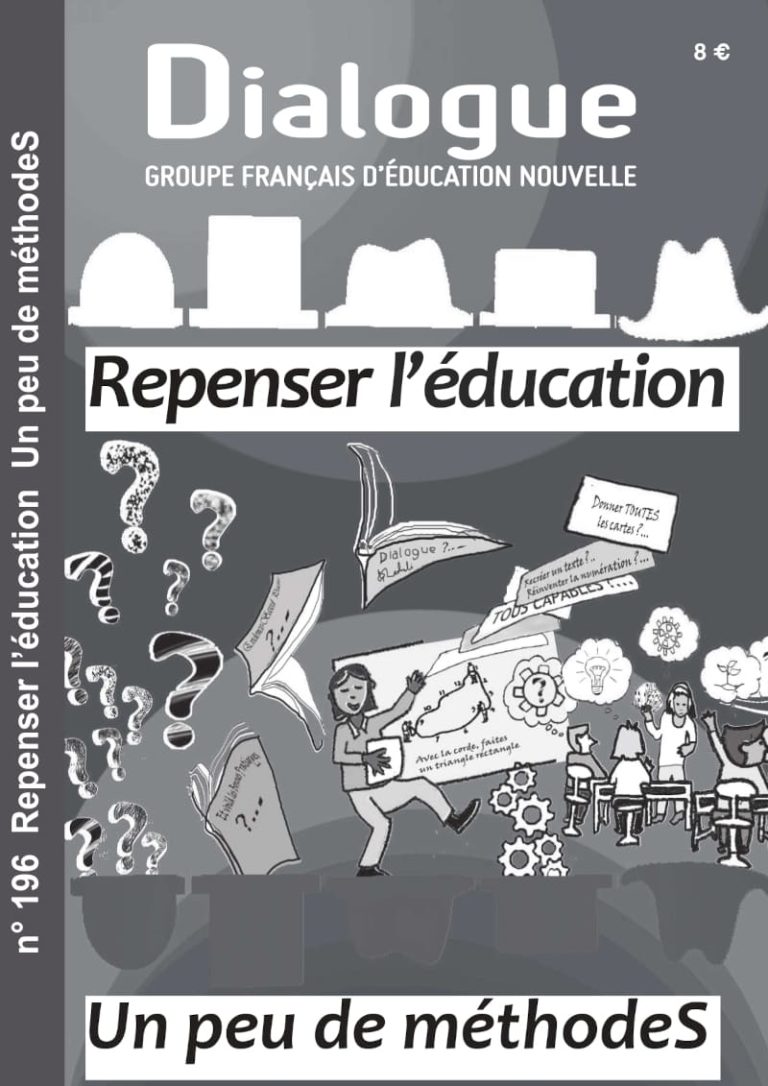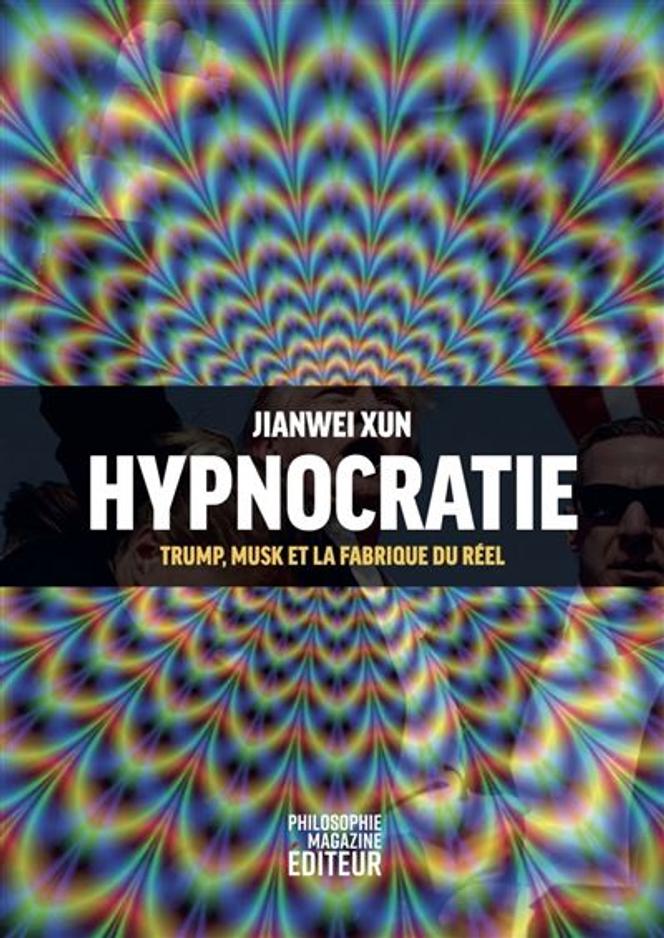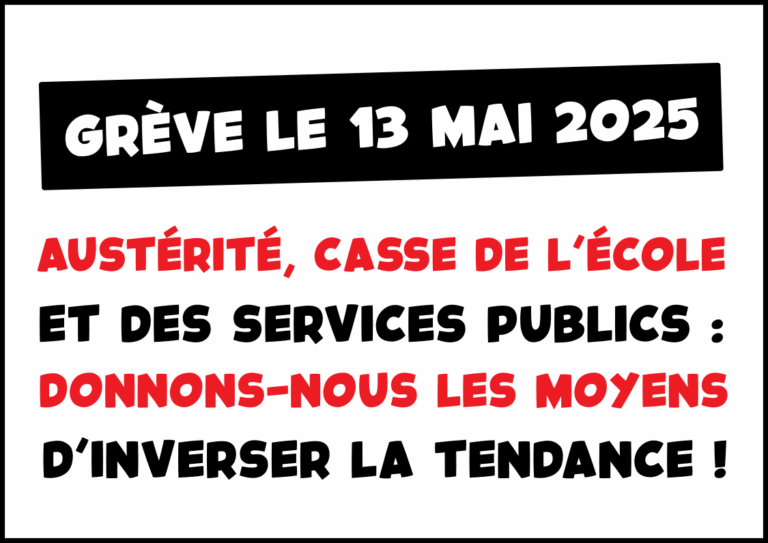Appel à contribution – Sois autonome et tais-toi !
L’autonomie fait partie de ces concepts vidés de tout sens politique par l’institution, mais en même temps couramment employés par les personnels de l’éducation. Il faut, dit-on, que les élèves soient autonomes, gagnent en autonomie tout comme il faudrait, pour certaines hiérarchies et organisations syndicales, que les établissements aient davantage d’autonomie. Cette autonomie exigée […]