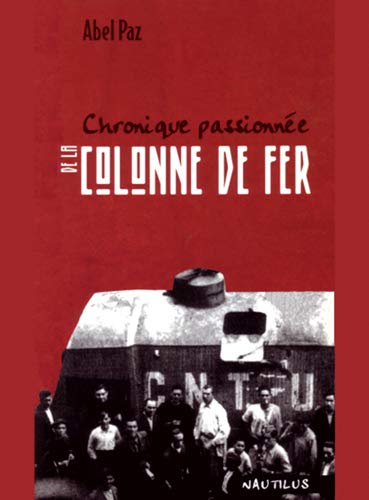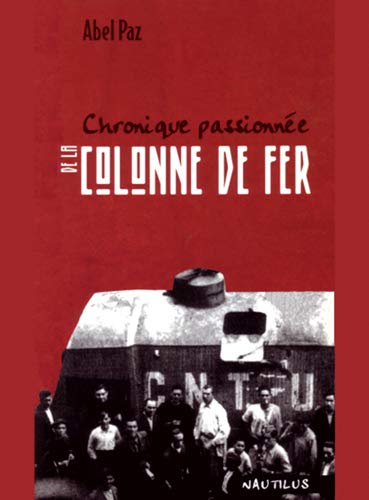L’auteur est un militant de la révolution espagnole devenu le chroniqueur de ces années de combat, et un des compagnons de Durruti (dernier ouvrage paru en français : Chronique passionnée de la Colonne de fer, Nautilus, 2002). Se croisent ici une enfance et une adolescence très vite engagée avec le rythme accéléré d’un espoir d’émancipation dans l’Espagne des années Trente.
Contrairement à beaucoup de mémoires, l’auteur évite l’auto-complaisance et l’énumération : sa recherche d’une enfance prolétaire baignée d’amour et de conscience sonne juste. Les sensations, les sentiments aussi dans leur éveil sont présents et mêlés aux premières lectures et à un engagement précoce ; la dureté des conditions de vie, les piquants de la figue de Barbarie, n’empêche pas d’accéder aux joies du quotidien : une école Ferrer où il va avec plaisir, des oncles si proches qui l’éduquent politiquement, les premiers émois sexuels ou amoureux : « ceux qui recherchent le bonheur à travers des biens matériels sont comparables à ceux qui voudraient emprisonner un rayon de lune », écrit ce syndicaliste de toute une vie.
Le prologue de Raoul Vaneigem échappe lui aussi à l’ennui que génèrent si souvent les préfaces : « j’aime à penser », dit-il, « qu’il y a dans cette énergie vitale qui l’a toujours guidée et dont nous sommes dépositaires, une puissance qui avance sur tous les fronts , ne tue pas et ne cède pas d’un pouce. » C’est qu’Abel Paz aimait à dire « J’ai pris le fusil mais je n’ai tué personne ».
On peut ainsi faire deux lectures de cet ouvrage : le bel écho d’un autre temps et d’un autre lieu, et/ou l’affirmation, certes située mais forte, du fameux « vivre, c’est lutter ».
Abel Paz, Scorpions et figues de barbarie, mémoires 1921-1936, Rue des Cascades, 2020, 320 p., 12 €.