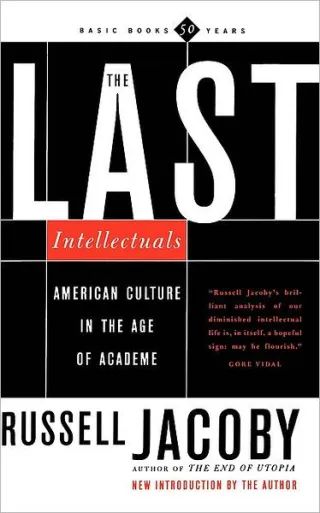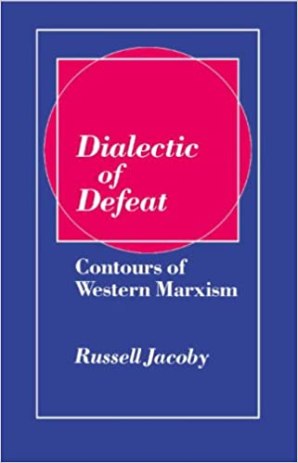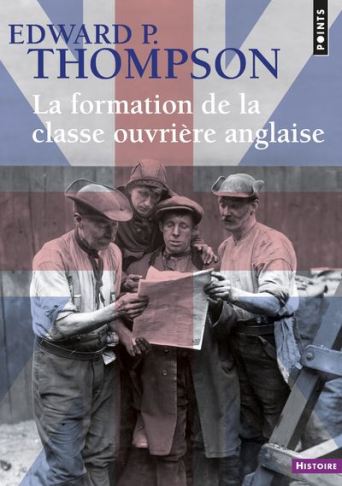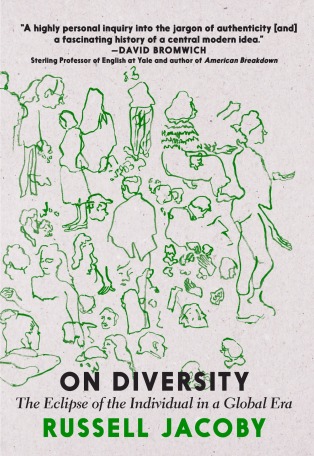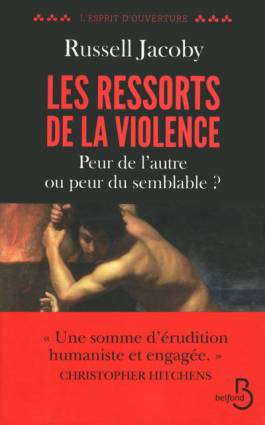Fabien Delmotte a mené en février dernier un entretien avec Russell Jacoby, l’auteur de l’ouvrage “Les derniers intellectuels”. Déjà publié sur A Contretemps et Le Comptoir il est l’occasion pour l’historien et militant américain de partager ses interrogations et critiques contre la portée subversive de la pensée radicale et révolutionnaire dans le milieu universitaire. Son bouquin interpelle et fait débat dans la “gauche américaine”. Il mérite d’être connu et ne manquera pas d’être discuté de ce côté-ci de l’Atlantique…
Si une politique émancipatrice n’est pas dissociable d’une pensée critique, il n’en demeure pas moins douteux qu’une telle tâche puisse être confiée au seul milieu professionnel universitaire. Ce problème a longtemps occupé l’historien américain Russell Jacoby. Son dernier livre, « On Diversity », interroge la portée limitée et finalement trompeuse d’un « jargon de campus » relatif à la « diversité », désormais largement employé dans l’espace public américain. Dès 1987, dans un livre qui fit date aux États-Unis, « The Last Intellectuals », l’auteur s’inquiétait, non sans susciter la polémique, des conséquences pour le débat public du poids croissant de l’université dans la vie intellectuelle. L’ouvrage, qui avait attiré l’attention d’auteurs comme E. P. Thompson ou Murray Bookchin, critiquait par là-même une nouvelle génération de professeurs, celle de l’auteur, formée au cours des années 1960 et 70, qui avait remis en cause l’establishment et l’institution universitaire avant de finir, plus qu’aucune autre auparavant – quoique sous des oripeaux « radicaux » – par l’intégrer.
Observateur peu complaisant de son propre milieu, professeur émérite de l’Université de Californie de Los Angeles, bien qu’il n’ait jamais obtenu un statut de titulaire, Russell Jacoby a écrit sur l’École de Francfort, sur les courants hétérodoxes du marxisme et de la psychanalyse, sur les ressorts de la violence ainsi que sur la signification de la pensée utopique. Il a, par ailleurs, sans nécessairement partager les dimensions parfois conservatrices de leurs analyses, côtoyé des penseurs comme Christopher Lasch ou le fondateur moins connu de la revue « Telos », Paul Piccone. Avec un intérêt constant pour les intellectuels étrangers au monde académique, voire dont l’œuvre s’est avérée inséparable d’une vie risquée de révolutionnaire.
Dès son premier livre, Russell Jacoby se proposait de lutter contre « l’amnésie sociale » qui empêche, par oubli du passé, de penser en termes adaptés la critique du statu quo présent au-delà des tendances dominantes du moment. Poursuivant cette inspiration, l’entretien qu’il nous a accordé ne se propose pas uniquement de présenter un parcours et une œuvre trop peu connue en France en dépit de son indéniable intérêt, mais d’offrir un éclairage historique ne concernant pas uniquement la vie intellectuelle américaine et permettant de soulever, dans une perspective émancipatrice, quelques questions significatives sur ce que devrait être la critique sociale contemporaine.
Fabien Delmotte : Avant d’aborder votre livre The Last Intellectuals, j’aimerais revenir sur les premières étapes de votre parcours dans la mesure où elles peuvent en éclairer le sens. Quelles étaient vos influences initiales ? Comment en êtes-vous venu à vous engager politiquement ?
Russell Jacoby : Je ne peux pas prétendre que ma trajectoire a été unique. Je suis né à New York à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de parents juifs laïcs, la semaine même où Hitler est mort. Mes parents appartenaient à une communauté informelle constituée en grande partie de juifs de gauche. Déjà, au lycée, j’étais un peu contestataire. L’un de mes premiers écrits scolaires s’opposait aux exercices de guerre nucléaire. La guerre froide était à son apogée – c’était les années 1950 – et, à l’occasion, l’école organisait des exercices de guerre nucléaire au cours desquels les élèves éloignaient leurs pupitres des fenêtres et se mettaient en dessous comme en cas d’attaque nucléaire. Ce n’était pas seulement ridicule ; cela rendait la guerre nucléaire acceptable. Au début des années 1960, un groupe national appelant au désarmement nucléaire s’est formé, auquel j’ai adhéré : le Comité national pour une politique nucléaire saine – National Committee for a Sane Nuclear Policy (« Sane »). Partout dans le pays, la situation politique commençait à chauffer : désarmement nucléaire, mouvement des droits civiques, guerre du Vietnam. De plus, toutes ces mobilisations étaient liées entre elles. Par exemple, Martin Luther King a soutenu le « Sane » et le désarmement nucléaire.
Après le lycée, je suis entré à l’Université de Chicago, mais la situation politique semblait sombre et déprimante par rapport à celle du Wisconsin, voisine de Madison, qui semblait vivante, animée. Au cours de ma deuxième année, je me suis donc fait transférer à Madison.
Quand je suis arrivé à l’Université du Wisconsin de Madison en 1964, j’ai découvert une Nouvelle Gauche – New Left – substantielle. L’une des premières revues de la New Left – Studies on the Left – est sortie de Madison. Deux professeurs réfugiés, George L. Mosse, issu de la famille qui avait possédé le plus grand quotidien allemand, et Hans Gerth, élève de Karl Mannheim, le sociologue, devinrent des mentors intellectuels pour nombre d’entre nous. L’Homme unidimensionnel d’Herbert Marcuse a paru en 1964, et j’ai rejoint ce qui était un petit groupe de marxistes de l’École de Francfort qui essayaient d’apprendre l’allemand et d’acquérir la compréhension de différents textes clés. Nous étions obsédés par Georg Lukacs et son Histoire et conscience de classe ; sa traduction anglaise n’a paru qu’en 1971. Bien que je n’aie jamais étudié directement avec aucune des personnalités de l’École de Francfort, j’ai étudié de près leurs travaux. J’ai eu des contacts avec Marcuse, qui a même écrit un texte de présentation pour mon premier livre, Social Amnesia : A Critique of Conformist Psychology. En même temps, avec mes confrères, j’étais actif politiquement, en particulier au sein du Comité pour mettre fin à la guerre au Vietnam – Committee to End the War in Vietnam. J’ai aussi rejoint Étudiants pour une société démocratique – Students for a Democratic Society (SDS).
Dès le début des années 1970, vous avez participé à la revue Telos, créée en 1968 par Paul Piccone.
Oui, Piccone a été le moteur de Telos. La revue a été fondée par des étudiants en philosophie de l’Université d’État de New York, à Buffalo. Elle a émergé à un tournant des années 1960, en mai 1968, et a cherché à briser l’emprise d’une philosophie provinciale anglo-américaine. Des traductions et des introductions aux penseurs et aux radicaux européens remplissaient les premiers numéros. Piccone venait d’une famille italienne de la classe ouvrière, ce qui l’a peut-être vacciné contre les clichés de gauche sur la classe ouvrière. « Nous ne connaissions que trop bien le “prolétariat” pour nous faire des illusions sur son prétendu potentiel émancipateur », a-t-il déclaré pour expliquer le rejet sans compromis par Telos du marxisme conventionnel.
Il se trouve qu’un autre Italo-Américain de gauche d’origine ouvrière a dirigé mon département lorsque j’étais à l’université. Comme Piccone, Eugene Genovese, un historien bien connu de l’esclavage américain, était vêtu de beaux costumes. La famille de Piccone exerçait le métier de tailleur. Genovese s’est un jour adressé à nous, une bande hétéroclite d’étudiants, principalement de New York et de sa banlieue, alors que nous nous promenions avec des bottes, des jeans et des chemises de travail : « Vous pensez que les travailleurs aiment ce que vous portez ? », ricana-t-il. « Ils le méprisent et vous aussi. » Il désigna alors ses vêtements soignés : « C’est ce qu’ils aiment, les travailleurs. C’est ce qu’ils porteraient s’ils le pouvaient. » Piccone aurait été d’accord. Ils avaient raison, bien sûr.
Piccone a rejeté le marxisme orthodoxe. Il a étudié la phénoménologie, en particulier Enzo Paci, philosophe italien qu’il a traduit en anglais. Lui et Telos ont cherché un nouveau type de marxisme et ont travaillé – et rejeté – diverses traditions, y compris l’École de Francfort et Habermas. Son esprit fonctionnait comme une scie à ruban, coupant ce qu’il considérait comme inutile dans la tradition radicale.
En voyant le film documentaire Velvet Prisons : Russell Jacoby on American Academia, j’ai appris que vous étiez à Paris aux alentours de Mai 68.
Aux alentours, mais pas en Mai 68 ! Je suis arrivé à Paris à l’automne suivant. J’ai raté Mai 68 de six mois, je suis désolé de le dire. Mais Paris paraissait toujours assiégé. La police anti-émeute – les CRS – semblait être partout ; ils attendaient la prochaine explosion, maussades, dans leurs bus au coin des rues. Il y avait de l’électricité dans l’air. J’étais officiellement à Paris pour assister à un séminaire donné par l’historien Georges Haupt, qui a également édité une série de livres sur le socialisme pour Maspero, mais je ne pense pas y avoir assisté une seule fois. Il y avait trop à faire ! Pendant un moment, nous avons tous été séduits par les situationnistes. À preuve, je logeais chez des amis dont le chat s’appelait « Guy Debord » (rires).
Vous venez toujours régulièrement à Paris, n’est-ce pas ?
The Philosopher [Portrait de Norbert Guterman] par Betty W. HubbardJe viens souvent à Paris, puisque ma compagne habite ici. Mais je n’ai jamais eu beaucoup de contacts avec les intellectuels français, peut-être parce que mon orientation intellectuelle reste liée à l’École de Francfort et au marxisme allemand. En fait, la relation entre le marxisme français et allemand m’a toujours laissé perplexe.
Bien plus tard, j’ai essayé d’écrire un livre – cela n’a pas eu lieu – sur le peu connu Norbert Guterman. Je m’intéressais à Guterman parce qu’il semblait être un lien vivant entre un marxisme critique allemand et français. Guterman a participé à l’École de Francfort. Dans les années 1920 et 30, il a vécu à Paris et a travaillé avec Henri Lefebvre. Lui et Lefebvre ont collaboré à plusieurs projets ; par exemple, ils ont publié en 1934 la première édition française des premiers écrits presque inconnus de Marx – le Marx « humaniste » qui a écrit sur l’aliénation. Les situationnistes ont beaucoup retenu de Lefebvre, notamment sa « critique de la vie quotidienne ».
« Nous ne connaissions que trop bien le “prolétariat” pour nous faire des illusions sur son prétendu potentiel émancipateur »
Vos premiers écrits critiquaient, au sein de la New Left, les approches focalisées sur le changement personnel et le bien-être individuel, qui sous-estimaient le besoin d’une transformation des structures sociales. Parallèlement, vous avez contesté les prétentions du marxisme « scientifique », qui entendait assurer la « ligne juste » par la science et la technologie ; et vous avez remis en question le fétiche de gauche du progrès. Cette question du progrès technologique vous préoccupe encore.
La remarque de Lénine selon laquelle « le communisme, c’est les soviets plus l’électrification » relève d’un marxisme simpliste. Il postule que la technologie est intrinsèquement progressiste et que tout ce dont nous avons besoin est de la démocratiser ou de la contrôler. En effet, les Soviétiques aimaient la technologie américaine, en particulier Henry Ford et Frederick Taylor. Croire que la technologie ne demande qu’à être mieux utilisée reste une option séduisante mais trompeuse. L’idée qu’une nouvelle société devra adopter la technologie de l’ancienne à ses propres fins fait l’impasse sur le fait qu’elle a toujours été le témoin des forces historiques qui en ont été porteuses. L’automobile relève-t-elle d’un fait technologique neutre ? Les « progressistes » ont souvent succombé au mythe selon lequel les avancées technologiques seraient toutes positives. Nous devons repenser ces questions. Dans mon dernier livre, On Diversity, un chapitre est consacré à la technologie et à son impact sur l’imagination et la spontanéité des enfants. Les enfants ont des IPad à partir de deux ans. Les poussettes sont aujourd’hui livrées avec des supports IPad. Mais que regardent ces enfants ? Le matériel est conçu par des adultes. Ces avancées technologiques envahissent l’espace déstructuré de l’enfance, qui est à la base de l’imaginaire. Le fait est que la technologie n’est pas neutre et que les avancées technologiques ne constituent pas nécessairement un progrès.
Vous vous êtes intéressés à l’École de Francfort, mais aussi, plus généralement, à la tradition « vaincue » du marxisme « occidental » (par opposition au marxisme soviétique). Vous y rangez, par exemple, Rosa Luxemburg, Karl Korsch ou Anton Pannekoek. Sans bien sûr renoncer à la possibilité de victoires politiques, vous critiquez « l’ethos du succès » lorsqu’il rend indifférent à la vérité et ne valorise que les gagnants ». Un ethos dont on retrouve la trace, non seulement chez les capitalistes, mais aussi dans les courants dominants du marxisme et de la gauche. Cette question du succès, sous différentes formes, est, comme nous le verrons, toujours centrale dans vos livres.
Mon deuxième livre, qui était en fait ma thèse – Dialectic of Defeat –, cherchait à renouer avec des traditions vaincues du marxisme. Cela soulève des questions qui, à mon avis, demeurent encore d’actualité : qu’est-ce qui fait le succès d’une politique de gauche ? Comment le juger politiquement ? Est-ce que ça prend dix, vingt, cinquante ans ? Le marxisme soviétique a fait taire toute critique de gauche pendant des décennies en raison de son « succès ». Le léninisme a fonctionné – jusqu’à ce qu’il ne fonctionne plus. Mais les premières critiques qu’on lui a adressées étaient prémonitoires et, à partir d’elles, on peut apprendre beaucoup sur ce qu’est une politique « réussie ».
Dans la décennie des années 1960, à bien des égards une certaine gauche a cherché le succès, ce qui l’a conduit à un tiers-mondisme douteux. Nous avions, aux États-Unis, des gauchistes qui voulaient suivre Mao ou le Che – parce qu’ils « avaient réussi ». Mais cela n’avait aucun sens. Les révolutions chinoise ou cubaine relevaient de conditions particulières : la lutte armée, l’organisation des paysans… Qu’est-ce que cela pouvait bien signifier à New York ou à Chicago ? C’était dingue. Et ces révolutions avaient-elles « réussi » ? Selon quels critères ? La gauche s’est toujours abîmée dans sa quête du succès.
« Les « progressistes » ont souvent succombé au mythe selon lequel les avancées technologiques seraient toutes positives. »
Votre remise en cause de la croyance dans le progrès découle aussi de votre critique de l’Université et de sa quasi-monopolisation de la vie intellectuelle. Vous en critiquez les conséquences et l’impact sur la pensée critique comme sur le rapport des auteurs au public. Peut-être pourriez-vous commencer par présenter le livre The Last Intellectuals. Ce livre, bien connu aux États-Unis, n’a hélas pas été traduit en français.
J’ai proposé une description générationnelle des intellectuels américains nés vers les années 1900, les années 1920 et les années 1940. Pour les premiers intellectuels américains, l’Université restait périphérique parce qu’elle était petite, sous-financée et éloignée de la vie culturelle. Les Edmund Wilson et Lewis Mumford, au début du XXe siècle, puis les Jane Jacobs et Betty Friedan se sont vus comme des écrivains et des journalistes, pas comme des professeurs.
Ce que j’ai appelé la « génération de transition » se composait d’intellectuels majoritairement juifs new-yorkais qui ont terminé leur carrière comme professeurs, mais manquaient généralement de formation universitaire. Lorsque Daniel Bell a été nommé à la faculté de l’Université de Columbia en 1960, les responsables ont découvert qu’il n’avait pas de doctorat et le lui ont accordé pour sa collection d’essais The End of Ideology. Cet incident indique quelque chose de l’engagement de ces hommes, car c’étaient des hommes ; ils ont écrit des essais lucides pour un public, pas des monographies ou des articles de recherche pour leurs collègues.
L’histoire change pour la génération suivante, ma génération, celle des années 1960. En termes de posture, nous étions beaucoup plus radicaux que les précédents intellectuels américains. Nous étions gauchistes, maoïstes, marxistes, tiers-mondistes, anarchistes. Et les manifestants que nous étions bloquaient régulièrement les facultés contre la guerre au Vietnam ou encore pour la liberté d’expression et l’égalité raciale. Pourtant, malgré tous les dénigrements que nous inspirait l’Université et contrairement aux intellectuels des générations précédentes, nous, nous ne sommes jamais sortis du campus. Nous nous y sommes installés. Nous sommes devenus des étudiants diplômés, des professeurs adjoints et enfin – pour quelques-uns – des personnalités de premier plan dans les disciplines universitaires. Contrairement aux intellectuels antérieurs, nous sommes devenus d’étroits spécialistes, pas des intellectuels publics [1].
L’ironie est que, alors que nous étions plus à gauche que la génération précédente, nous nous consacrions davantage à réussir dans les institutions établies comme l’Université. Nous avons construit nos réseaux, participé à des colloques, cultivé la bienveillance de collègues qui pourraient nous aider dans notre carrière. Une philosophie anarchiste avait infusé le mouvement au cours des années 1960, mais cet esprit a disparu.
Les premiers écrivains de gauche américains étaient des intellectuels publics, pas seulement des professeurs. Considérez un livre comme Monopoly Capital (1966), de Paul Sweezy et Paul Baran, qui a eu une grande influence et a été écrit pour être lu. Et regardez aujourd’hui les principaux marxistes ou gauchistes américains. Ils sont essentiellement connus des étudiants, des gens comme Homi Bhabha à Harvard, Frederic Jameson à Duke, Gayatri Spivak à Columbia ou Judith Butler à Berkeley : ils ne peuvent pas ou ne veulent pas écrire une phrase claire. Leurs travaux sont lus par des collègues ou des étudiants.
En même temps, un mépris pour le journalisme a surgi. L’un des commentaires les plus dommageables sur le travail de quelqu’un à l’Université est qu’il est « journalistique ». Cela signifie qu’il est lisible et superficiel. La présomption est que le jargon et l’obscurité indiquent une pensée profonde et subversive. Bien sûr, c’est de la foutaise. Lisez Marx ou Nietzsche ou Freud ; le meilleur de leur travail tient à sa clarté d’exposition, à sa lucidité.
Je dois préciser qu’à l’origine j’avais prévu que The Last Intellectuals serait une étude comparative ; c’est-à-dire que j’avais l’intention de m’intéresser tout à la fois aux intellectuels américains, français, allemands et anglais. J’avais l’intention d’argumenter de la même manière à propos de l’évolution de la vie intellectuelle dans chaque pays. Malgré toutes les différences qui existent entre la France et les États-Unis, nous voyons certaines évolutions similaires. Considérez le passage, disons, de Sartre et Camus à Althusser, Lacan, Foucault ou Derrida. Évidemment ces auteurs étaient bien connus, mais ils étaient beaucoup plus spécialisés, professionnalisés, que Sartre et Camus ; ils étaient beaucoup plus insulaires, obscurs. En effet, ils avaient la réputation d’être cryptiques, ce qui n’était certainement pas le cas de Sartre ou de Camus. Contrairement à la génération précédente, ils n’étaient pas des intellectuels publics. J’ai renoncé à l’aspect comparatif du livre comme trop lourd, et me suis concentré simplement sur les États-Unis.
Beaucoup de personnes voient dans la « professionnalisation » universitaire quelque chose de positif, favorisant l’autonomie de la pensée ou la recherche de la vérité, par opposition aux impératifs du marché et des médias.
Je ne souhaite pas participer de cet anti-intellectualisme toujours latent aux États-Unis. Oui, les universités peuvent être des refuges pour les penseurs universitaires, en les protégeant des pressions du marché et du gouvernement. En même temps, il serait naïf de ne pas se pencher sur les impératifs qui définissent la vie universitaire. Combien de professeurs cherchent la vérité ou la défendent ? J’ai récemment écrit sur la saga Salman Rushdie. Combien de professeurs américains de littérature – et ils sont des milliers – ont franchement et publiquement défendu Rushdie et la liberté d’expression ? Je crois que la réponse est : zéro. Pourquoi donc ?
En 1976, j’ai écrit un article – célèbre dans de très petits cercles – intitulé « La baisse du taux d’intelligence ». Il soutenait que le commandement capitaliste « Accumule ou péris » s’appliquait à l’Université, où il était formulé sous la forme « Publie ou péris ». Vous devez publier, et peu importe quoi. De nombreuses études confirment que seule la quantité – et non la qualité – compte dans le monde universitaire. La plupart des articles de sociologues ne sont pas lus. Ils sont listés ou cités. C’est le produit qui compte. Il existe une source de références, The Citation Index, qui a été utilisée comme critère pour faire avancer les carrières. Il mesure simplement la fréquence à laquelle un auteur a été cité ou noté en bas de page. Plus vous êtes cité, plus vous êtes important. Et il existe, bien sûr, un lien direct entre le nombre de publications et le nombre de citations. Que votre travail ait du mérite, ou pas, ne fait pas pertinence.
« L’ironie est que, alors que nous étions plus à gauche que la génération précédente, nous nous consacrions davantage à réussir dans les institutions établies comme l’Université.«
Vous attirez souvent l’attention du lecteur, avec un regard critique, sur le rôle des remerciements dans les ouvrages universitaires.
Les miens sont courts. Mais dans le livre académique typique, ils ressemblent à des annuaires téléphoniques – des pages et des pages de noms, de contacts, d’institutions, de récompenses. Il est évident que les remerciements sont des actes de constitution de réseau ou de construction de carrière. Ils déclarent l’importance de l’auteur, le nombre de personnes qu’il connaît. C’est une déclaration disant : « Regardez ! Je suis un acteur dans ce domaine. Je traîne avec des sommités universitaires. Je suis invité à de nombreuses conférences. » C’est aussi un avertissement à l’égard de tout critique qu’on pourrait exprimer ainsi : « Voyez combien de personnes influentes je connais ! Voyez combien d’ennemis vous vous ferez si vous attaquez mon livre ! ».
Vous pensez que les conditions matérielles influencent la pensée et vous portez une attention particulière aux transformations socio-économiques, comme la gentrification des villes, qui ont modifié la vie intellectuelle.
Oui, pour le coup je suis toujours marxiste. Les anciens intellectuels menaient en quelque sorte une vie de bohème. C’étaient des écrivains indépendants, précaires ; ils vivaient dans les villes et traînaient dans les cafés. Ma génération, au contraire, a grandi sur les campus universitaires et n’en est jamais partie. Ces conditions matérielles ont conduit à des écrits très différents, non pas des essais lucides visant un public, mais des essais savants s’adressant à collègues spécialisés – ou à des fondations pour des demandes de subvention. Pour réussir vous devez faire très attention à qui vous critiquez. Il s’agit désormais d’évoluer dans de minuscules champs académiques où votre avenir dépend du soutien de collègues.
Ce n’est pas là une question de faillite morale. L’entrée à l’Université est liée aux réalités économiques et urbaines. Les magazines grand public ont décliné. Les villes sont devenues plus chères et les universités se sont développées rapidement. La bohème urbaine à bon marché a pratiquement disparu. Quand Edmund Wilson publiait dans The New Republic dans les années 1920, il devait être payé quelque chose comme 200 dollars. C’est essentiellement la même somme que ce que vous perceviez dans les années 1960. Avec ça, dans les années 1920, vous pouviez louer un appartement et y vivre quelques mois. Dans les années 1960, vous pouviez encore prendre quelques bons repas. L’économie de la bohème urbaine s’est transformée. Pour un aspirant intellectuel, tous les signes pointaient donc vers l’Université.
L’université Yale à New Haven
Mes propres élèves me disent parfois « oh ! je veux être un intellectuel ». Eh bien, si vous voulez être un intellectuel en Amérique, leur dis-je, vous avez trois choix (rires) : soit vous avez une femme ou un mari qui va travailler et vous soutenir ; soit vous avez une famille riche et vous n’avez pas à vous soucier de gagner votre vie ; soit vous vous engagez dans une carrière universitaire. Cela dit, cette dernière option – la plus courante – occasionne des coûts élevés. Vous entrez certes à l’Université dans l’espoir de devenir un intellectuel et de résoudre des problèmes généraux, mais gravir les échelons académiques coûte cher. Après dix à quinze ans d’exercice, vous devenez, si vous avez de la chance, titulaire et acquérez la sécurité qui vous permet d’écrire ce que vous voulez. Mais, à ce moment-là, vous avez oublié ce que vous vouliez écrire ou vous n’en êtes plus capable ; vous êtes devenu un professeur spécialisé, pas un intellectuel public.
Dans un de vos livres précédents centré sur le psychanalyste Otto Fenichel – Otto Fenichel : destins de la gauche freudienne –, vous défendiez l’idée que la psychanalyse avait perdu une partie de son sens une fois qu’elle avait été « professionnalisée » et intégrée à la vie américaine comme discipline légitime et respectable.
Oui, c’était tout à fait cohérent avec The Last Intellectuals, et avec Freud lui-même. Un de ses livres probablement les moins lus – peut-être à cause de son titre peu engageant – mais l’un de ses plus clairs et des plus prémonitoires est La Question de l’analyse profane.
Dans cet ouvrage, Freud défendait la psychanalyse face aux médecins. Il y manifestait sa crainte que la profession médicale ne s’empare de la psychanalyse et n’en fasse une thérapie coûteuse, ce qui est plus ou moins ce qui s’est passé aux États-Unis. En d’autres termes, il voulait que la psychanalyse joue un rôle dans la vie intellectuelle publique et qu’elle ne devienne pas le monopole des médecins.
Je ne pense pas que ce soit un accident de l’histoire – pour reprendre la vieille expression marxiste – si certains des psychanalystes les plus importants n’avaient pas de diplômes de médecine. Je pense à des gens comme Erich Fromm et Erik Erikson.
The Last Intellectuals décrit précisément ce changement général des conditions de la vie intellectuelle américaine. Mais c’est aussi, on l’a vu, un commentaire sur l’intégration de la gauche au sein de l’université ainsi que sur l’effondrement de la New Left et des espoirs révolutionnaires. Ici, nous vous trouvons en train de vous demander ce que signifie le succès. Cette nouvelle présence de la gauche à l’université est-elle une réussite politique ? Après tout, les mouvements conservateurs ont réussi pendant des décennies à remporter des victoires et même à capter le mécontentement populaire sans base universitaire.
Je pense que c’est un enjeu décisif. L’Université se déplace vers la gauche alors que le reste de la société se déplace vers la droite. Qu’est-ce que cela signifie ? Là encore, cela renvoie au problème de « l’académisation » de la gauche. Si nous avons de grands gauchistes à l’université, ils se parlent surtout entre eux. Ironiquement, les conservateurs, qui se sont historiquement méfiés des bureaucraties et de la professionnalisation, ont réussi à maintenir en vie un discours plus clair et engageant que les professeurs de gauche.
Le livre est désormais bien connu aux États-Unis mais quelle a été la réaction à la sortie de l’ouvrage, en 1987 ?
Les professeurs n’ont pas aimé. Toutes les remarques habituelles m’ont été assénées. J’aurais été nostalgique de certains intellectuels (« vieux et blancs »). Bon débarras !, me disait-on. Désormais, nos intellectuels sont plus diversifiés, plus sophistiqués, plus théoriciens que ceux de la génération précédente. Les choses avançaient ! Je regardais en arrière ! Les platitudes habituelles, en somme.
Il y eut tout de même une réaction positive, celle d’E. P. Thompson dans un long texte où il évoquait ses rapports conflictuels avec l’Université et sa propre expérience de recherche et d’écriture hors circuit académique traditionnel pour son livre phare : La Formation de la classe ouvrière anglaise. Votre ouvrage a également provoqué des réactions d’universitaires qui, comme Edward Saïd, en ont au moins reconnu l’importance.
Le texte d’E. P. Thompson, intitulé « Reflections on Jacoby and all that », n’a été publié que récemment. Petites critiques mises à part, je pense que Thompson était fondamentalement en accord avec moi. Edward Saïd, lui, avait davantage d’objections, même s’il a repris mon argumentaire dans son livre Des intellectuels et du pouvoir. Peut-être suis-je injuste, mais je ne peux m’empêcher de penser que les propos de Thompson et ceux de Saïd s’accordent à leurs carrières et aux choix divergents qu’ils ont faits par rapport à l’institution. Thompson a enseigné pendant des années dans le domaine de l’éducation pour adultes, ce qui signifie qu’il dispensait son savoir à des adultes qui avaient un emploi pendant la journée et suivaient des cours le soir. D’un point de vue académique, ce n’est pas un travail prestigieux, mais cela atteste de l’engagement de Thompson à apporter des connaissances dans la communauté, là où les gens vivent et travaillent.
Saïd, de son côté, a passé sa vie dans des écoles d’élite ; il est allé à Prhttps://acontretemps.org/spip.php?article976inceton et à Harvard et est devenu un professeur très honoré à Columbia. Contrairement à Thompson, il était un peu sur la défensive et percevait mes critiques comme des attaques contre le corps professoral. Ainsi, il résuma mon argumentaire pour le réfuter. Mais en quoi consistait sa réfutation ? Il déclara qu’être un intellectuel public n’était « pas du tout incompatible avec le fait d’être universitaire ». Et il en donna des exemples. L’un d’eux fut celui du « brillant pianiste canadien Glenn Gould ». L’exemple était, à vrai dire, d’autant plus étrange que je n’abordais nulle part la question des musiciens et que, quels que soient ses mérites, il serait difficile de classer Gould parmi les « intellectuels publics ». Saïd avança d’autres d’exemples et, parmi ceux-ci, le fait que des historiens avaient eu « une large diffusion au-delà de l’académie». Qui proposait-t-il comme exemple ? E. P. Thompson, Eric Hobsbawm et Hayden White. Mais ces exemples ne font pas mouche puisque Hobsbawm, Thompson et White n’étaient pas des universitaires tout à fait comme les autres : le premier est resté membre à vie du Parti communiste britannique ; le deuxième, comme je l’ai dit, n’était guère un universitaire classique ; le troisième, quant à lui, je suis désolé de l’annoncer, n’a pas eu une « large diffusion » hors de son campus. Il n’était connu, en fait, que de sa classe de théorie.
Votre livre The Last Intellectuals procède à l’examen de nombreux exemples ; vous y constatez que les anarchistes américains relevaient d’une relative exception dans le cadre de vos observations. Vous évoquez, par exemple, la figure de Chomsky, critique de la collusion entre intellectuels et pouvoir. Vous notez que, même s’il était professeur, Chomsky-comme-critique agissait en tant qu’ « outsider ». Il était professeur titulaire de linguistique, mais pas spécialiste accrédité en politique étrangère, le domaine qui l’a surtout fait connaître. Vous prenez également Murray Bookchin comme exemple de penseur radical anarchiste non universitaire. Vous observez que si certains progressistes ou marxistes encouragent la prise du pouvoir comme moyen de transformation sociale, conception où « carriérisme et révolution » sont susceptibles de converger, les anarchistes, eux, « se méfient des grandes institutions, de l’État, de l’Université et de ses fonctionnaires. Ils sont moins vulnérables – écrivez-vous – à la corruption des titres et des salaires car leur résistance est morale, presque instinctive ».
Il y a de cela. L’impulsion anarchiste doit infuser la gauche, en particulier sa suspicion à l’égard de l’autoritarisme et de la bureaucratie. Eh oui ! Chomsky a réussi à emprunter une voie que peu d’intellectuels ont suivie. Il a acquis une titularisation et une expertise dans un domaine – la linguistique –, mais s’est ensuite tourné vers un domaine sans aucun rapport pour devenir un critique véhément de la politique étrangère américaine. Autrement dit, il serait difficile d’imaginer Chomsky en tant que professeur titulaire de science politique.
Je connaissais un peu Murray Bookchin [2]. Je lui ai même proposé, à une certaine occasion et en forme de demi-blague, d’écrire un livre ensemble. Un livre américain très populaire de récente parution s’intitulait Tout ce que vous voulez savoir sur le sexe sans jamais oser le demander (livre de David Reuben, publié en 1969, qui fut adapté au cinéma sous le même titre par Woody Allen en 1972). J’ai proposé à Bookchin que nous écrivions « Tout ce que vous voulez savoir sur les sectes mais que vous avez peur de demander ». C’était une référence aux groupes sectaires marxistes et de gauche qui proliféraient partout. Je doute que le jeu de mots amuse en français. Mais il y a une double blague ici. Je l’ai proposé à Murray parce qu’il était très familier – plus que familier, même – de la politique sectaire de gauche ; c’était un pratiquant, pour ainsi dire. Cela pointe d’ailleurs un paradoxe qui mine certaines formes d’anarchisme. D’un côté, les anarchistes comme Bookchin et d’autres, peut-être les situationnistes, étaient antiautoritaires. D’un autre côté, ils étaient eux-mêmes incroyablement autoritaires et purgeaient régulièrement les membres qui ne suivaient pas la ligne. Les situationnistes expulsaient régulièrement des membres pour diverses infractions théoriques. Bookchin était très charismatique, mais il fallait être d’accord avec lui. Il voulait des adeptes. J’avais l’habitude de qualifier Murray Bookchin – en privé ! – d’« anarcho-stalinien » (rires).
Murray Bookchin (1921-2006)
Vous soulignez la trajectoire distincte et indépendante de la revue Telos, que nous avons déjà évoquée à propos de la Nouvelle Gauche. Dans Telos, le lecteur curieux trouvait, durant les années 1980, des textes de Castoriadis, de la nouvelle génération de l’École de Francfort et bien d’autres choses. Cette revue a aussi connu de vifs conflits sur les chemins que devrait dorénavant emprunter la pensée critique. La publication s’est tournée vers le développement d’un nouveau populisme, inspiré par Christopher Lasch ; et elle a ouvert un dialogue avec des auteurs plus conservateurs ou « libertariens », voire d’extrême droite, en s’intéressant par exemple à Carl Schmitt. Vous n’avez pas emprunté cette voie.
Schmitt, c’était trop pour moi ! Mais Piccone n’avait pas tout faux. Il était désormais convaincu que la gauche était plus ou moins carriériste et cherchait des emplois dans l’Université ou la bureaucratie d’État. La résistance, pensait-il, viendrait d’ailleurs, peut-être de la rue, des quartiers, des gens du peuple. Il croyait aux groupes auto-constitués qui font les choses par eux-mêmes, de bas en haut. Je pourrais ajouter qu’il a pratiqué ce qu’il a prêché. Il sortait physiquement Telos, avec l’aide de bénévoles ; c’est-à-dire qu’il préparait les pages pour l’impression, les apportait à l’atelier de reliure; transportait le magazine terminé au bureau de poste. Il a également joué un rôle déterminant dans l’achat d’un immeuble avec des dizaines d’autres personnes dans le Lower East Side de New York, où ils ont tous emménagé, non pas pour vivre en commun – chacun avait son propre appartement – mais pour posséder un lieu et prendre des décisions ensemble. C’était du populisme en action !
Vous connaissiez Christopher Lasch, dont l’œuvre a également été remarquée en France. Quel regard portez-vous sur lui ?
Christopher Lasch a été le directeur de ma thèse de doctorat et a écrit l’introduction de mon premier livre, Social Amnesia. Il pourrait être qualifié de penseur à la fois de gauche et de droite. Il est issu de la gauche, mais en a été désenchanté par certains aspects, un peu comme Piccone. Il a, par exemple, remis en cause la professionnalisation de la garde d’enfants et le rejet de la famille par la gauche, qui n’y voyait qu’un lieu d’oppression. À la fin de sa vie, il est devenu une bête noire de la gauche. Je crois, pourtant, qu’il a beaucoup à nous apprendre.
Lasch ainsi que certains contributeurs de Telos ont commencé à cibler ce qu’ils appelaient une « nouvelle classe », que Piccone considérait comme un véhicule de « négativité artificielle », une façon dont le système existant fabrique la contestation pour valider le statu quo. Dans le même ordre d’idée, la gauche américaine a popularisé ces dernières années une expression inventée par Barbara Ehrenreich, récemment disparue, à savoir la « classe professionnelle-managériale », que Catherine Liu a aussi utilisée dans un petit livre, Le Monopole de la vertu. Êtes-vous intéressé par cette question ?
Oui, bien sûr, mais il existe une quantité de variations sur ce thème. J’ai écrit moi-même une postface au livre de C. Wright Mills, Les Cols blancs, qui présentait une argumentation similaire. Mills s’était lui-même inspiré d’une ancienne littérature sociologique allemande sur cette « nouvelle classe », qui n’est pas la classe ouvrière ou dirigeante. Je pense qu’il y a là quelque chose à creuser. Il est évident que l’éclipse de l’ancienne classe ouvrière, sur le plan à la fois numérique et en tant qu’entité subversive, mérite d’être étudiée, tout comme l’émergence de la classe managériale. L’un des meilleurs commentaires, à ma connaissance, sur cette nouvelle classe, on le trouve dans le livre de l’ex-trotskyste James Burnham, L’Ère des organisateurs (1941).
Christopher Lasch (1932 – 1994)
Sans être particulièrement optimiste, vous refusez le cynisme et la résignation, et plaidez pour le maintien d’une perspective « utopique » laissant ouverte la possibilité d’un changement radical. Si l’amnésie sociale peut contribuer à entériner le statu quo, l’absence de représentation d’un autre futur peut, de même, nous conduire à se contenter d’une notion très appauvrie de la diversité des possibles.
Je fais valoir que le moment utopique est crucial pour un projet de gauche. Si vous l’abandonnez, que reste-t-il ? Des rues plus propres et de meilleurs parcs ? Ces choses ne sont pas sans importance mais, historiquement, l’espoir d’une transformation de la société a séparé la gauche des simples réformateurs. Mais cet espoir s’est évaporé. Regardez les grèves récentes en France [3] et comparez-les à celles des années 1960, lorsque les syndicats se sont également mis en grève. Mais maintenant, il n’y a même pas un petit souffle de changement fondamental dans l’air. L’enjeu est de maintenir l’âge de la retraite à 62 ans. L’espoir d’une transformation sociale s’est transformé en espoir de prendre sa retraite.
« Aux États-Unis la gauche a renoncé à son engagement en faveur de la liberté d’expression. »
Y a-t-il un rapport entre la fin des intellectuels indépendants et celle de l’utopie ?
C’est une bonne question, mais je n’ai pas de bonne réponse à lui apporter. Je pense qu’une telle relation existe probablement. Je soupçonne que les utopistes ont tendance à être des inadaptés ou des marginaux, qui ne sont pas des professionnels qui réussissent ; et comme les espaces culturels qui ont permis aux intellectuels inadaptés et marginaux de survivre se sont réduits, le projet utopique a perdu de sa force. Cependant, l’histoire du projet utopique est déprimante. Cela doit être admis. Le XVIe siècle nous a donné le terme « utopie », le XXe celui de « dystopie ».
Dans les années 1990, alors que s’imposait, selon vous, une nouvelle « idéologie de la fin des idéologies », les universités d’élite ont développé des programmes de diversité. Même si vous étiez opposé aux différentes discriminations, vous observiez que la gentrification de l’enseignement supérieur et l’homogénéité d’un point de vue de classe allaient s’accentuant. Dans votre dernier livre, On Diversity, vous affirmez que cet effort de diversité s’est propagé à travers les États-Unis jusqu’aux commissariats et aux multinationales. Vous vous demandez à nouveau si nous ne sommes pas confrontés à un troublant processus d’homogénéisation et d’uniformisation.
Dans On Diversity, je conteste l’idée que le monde se diversifie. Il me semble assez évident que c’est le contraire qui se produit. Une forme similaire de consumérisme s’est répandue dans le monde entier. Il est bizarre qu’à mesure que le monde devient moins diversifié, l’idéologie de la diversité fleurisse. On pourrait dire que l’idéologie de la diversité est une réponse à l’éclipse de la diversité. À mesure que les gens deviennent moins différents, ils fétichisent les différences persistantes. Ils prétendent qu’ils sont plus différents qu’ils ne le sont.
L’idéologie de la diversité, issue de l’Université, s’est répandue dans tout le pays. Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Habituellement, cela évoque l’appartenance à un groupe. Avons-nous le nombre proportionné de Latinos, d’Afro-Américains, d’Américains d’origine asiatique et d’autres groupes dans nos institutions ? Proportionné à quoi ? À leur proportion dans la population. Mais ce n’est là qu’une approche mécanique. Il s’agit d’un effort pour s’assurer que chaque partie de la société reflète des réalités démographiques plus larges. Non seulement c’est un objectif douteux, mais qu’est-ce que cela a à voir avec la diversité, surtout si tout le monde est d’accord ? Où entre en compte la diversité intellectuelle ?
De plus, cette diversité démographique participe de l’éclipse de l’individu quand la diversité mécanique n’a de sens que si l’individu représente le groupe. D’où les préliminaires typiques dans de nombreux débats ou controverses : « je parle en tant qu’Afro-Américain… » ; « je parle en tant que Latino… » ; « je parle en tant que lesbienne… ». L’individu s’évanouit dans l’identité de groupe. La gauche défend avec une égale véhémence deux positions opposées. D’une part, elle croit que l’identité est totalement « construite », et que vous pouvez être de n’importe quel sexe – ou orientation sexuelle –, n’importe quelle personne. D’autre part, l’identité relève du sang ou de la génétique. Bon gré mal gré, vous êtes simplement membre d’un groupe racial ou ethnique.
Vous critiquez l’idée conventionnelle de « succès » que suppose cette idéologie de la diversité, qui est essentiellement quantitative : « plus de choses, plus d’objets, plus de voitures, plus de cultures ». Si tout le monde vise les mêmes choses, où est la diversité ?
Exactement… Nous conduisons notre Mercedes aux conférences sur la diversité. Nous utilisons Google et faisons du shopping sur Amazon quand nous rentrons à la maison. Les seuls groupes que l’on saurait qualifier de divers sont ceux qui ne veulent pas faire partie de cette société, par exemple les Amish. Mais ils sont sans importance – et en partie sans importance parce que, précisément, ils ne veulent pas participer à la société industrielle avancée. Ils ne veulent pas en être, j’insiste, ils veulent garder leurs distances. Ils ne veulent même pas d’électricité. Mais les principaux groupes en faveur de la diversité partagent, eux, la même vision du monde ; ils veulent plus ou moins les mêmes choses. Ils veulent être admis, pas laissés de côté. Pour les progressistes, l’idéologie de la diversité est simplement une idée fourre-tout. En l’absence de véritable vision ou programme, ils s’accrochent à la diversité. La diversité est l’opium de la gauche.
Votre livre Les Ressorts de la violence : peur de l’autre ou peur du semblable ? tentait d’établir que, dans l’histoire, les petites différences narcissiques se sont révélées plus dangereuses que les authentiques altérités.
Mon livre sur la violence remet en question l’idée de grandes différences entre les peuples. C’est une supercherie de la pensée libérale et de gauche que de dire que nous craignons l’étranger, et que la peur conduit à la violence.
Depuis Caïn et Abel jusqu’à nos jours, la plupart des violences ne proviennent pas d’étrangers, mais de frères ou de personnes apparentées. Aux États-Unis du moins, la plupart des violences sont domestiques, se déroulant au sein de la famille ou entre membres de la famille. Votre cuisine bien éclairée est plus dangereuse qu’une rue sombre la nuit. Et la plupart des guerres sont entre des peuples qui ont beaucoup en commun. Pas contre des étrangers ! Regardez la guerre entre l’Ukraine et la Russie aujourd’hui.
Mais cette idée est désagréable. On préfère parler d’hostilité ou de peur de l’étranger.
« L’idéologie de la diversité est une réponse à l’éclipse de la diversité. »
Pouvez-vous nous parler des difficultés rencontrées pour publier vos travaux ? Vous regrettez un manque de diversité intellectuelle dans le monde universitaire américain. Vous dénoncez l’évitement et la censure qui priment sur les réponses raisonnées, ainsi que les atteintes à la liberté d’expression. Vous craignez la confusion entre le langage de la bureaucratie et le langage de la libération.
C’est là une question complexe. Oui, j’ai eu de sérieuses difficultés à publier mon livre On Diversity, et j’ai failli abandonner. Je suis passé par une dizaine d’éditeurs. Les éditeurs universitaires considéraient le livre comme trop éloigné du consensus de la gauche libérale. J’attaquais la diversité ! Dieu nous pardonne ! Le livre abordait le sujet d’un point de vue de gauche, mais la gauche est devenue susceptible, portée à la censure et prompte à juger. Vous devez être d’accord ou vous êtes de droite. Ces dernières années, aux États-Unis, la gauche a renoncé à son engagement en faveur de la liberté d’expression.
Pour conclure, il convient de préciser qu’aux États-Unis l’expression « intellectuel public » que vous avez largement introduite – même si l’expression existait dans les écrits de C. Wright Mills, que vous citez – est désormais reprise à toutes les sauces. Vous n’aviez évidemment pas en tête l’expert des médias ou la star des émissions de télévision…
Pour sûr…
Fabien Delmotte
- Lien vers le site de A Contremps : https://acontretemps.org/spip.php?article976
- Lien vers le site du Comptoire : https://comptoir.org/2023/04/27/dune-pensee-critique-sous-emprise-un-entretien-avec-russell-jacoby/
Notes
[1] L’expression « intellectuel public » est désormais courante aux États-Unis, mais elle ne l’était pas avant la publication de The Last Intellectuals. Elle est donc conservée ici, même si elle est peu habituelle en français.
[2] À noter qu’on peut trouver, en ligne, deux textes de Murray Bookchin sur la question des intellectuels. Le premier, gratuit, commente incidemment le livre de Russell Jacoby : https://theanarchistlibrary.org/library/murray-bookchin-intelligentsia-and-the-new-intellectuals. Le second, lui, est en accès payant : http://journal.telospress.com/content/1987/73/182.abstract.
[3] Cet entretien a été réalisé en février 2023.