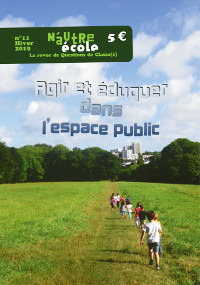Ce numéro de la revue N’Autre école témoigne de pratiques pédagogiques, associatives et militantes qui, toutes se déploient dans les espaces publics, et s’adressent aussi aux enfants qu’aux adultes. Agir dans l’espace public questionne notre manière de voir et penser la rue : faire de la rue un espace d’apprentissage et de partage, oblige à faire avec les gens et leur réalité, tels qu’ils sont, en tenant compte des conditions de vie et en assumant les marges. Dans leurs conditions d’exercice, comment ces expériences permettent-elles de rencontrer celles et ceux qui ne fréquentent pas ou plus les lieux institutionnalisés, et notamment les personnes les plus précarisées de notre société ? Comment ces expériences transforment-elles l’espace commun et posent-elles les conditions d’une émancipation ?
A commander sur notre librairie ! Agir et éduquer dans l’espace public (n° 11) (questionsdeclasses.org)

Assumer la vie ! par Guillaume Sabin
Guillaume Sabin est ethnologue et investi dans plusieurs expériences d’éducation populaire, les Groupes de pédagogie et d’animation sociale pratiquent la pédagogie sociale depuis bientôt 40 ans sur différents territoires bretons, urbains et ruraux, ainsi qu’à Varsovie (Pologne). Les pédagogues de rue agissent auprès d’enfants et d’adolescents sans locaux d’accueil, ils utilisent donc l’espace public comme lieu et ressource pour agir.
Le hors-les-murs est une pratique solidement ancrée chez les pédagogues des Groupes de pédagogie et d’animation sociale. Signe de leur fréquentation assidue de l’extérieur, à Rennes les familles ignorent pour la plupart l’existence du petit local où se réunissent et déjeunent les pédagogues, et à Brest si le local est davantage connu c’est que les pédagogues s’installent souvent sur le pas de porte qui donne directement sur la rue, discutant avec les enfants, les familles et les quidams de passage. Et cette pratique du hors-les-murs impose d’elle-même ses exigences qui ne relèvent pas uniquement, loin s’en faut, des contingences météorologiques ou de logistique. Si la logique de la pédagogie sociale (multiplier les rencontres, assumer la diversité sociale, et pour cela exécuter quotidiennement des gestes dotés d’un coefficient maximum de sociabilité) impose presque d’elle-même la fréquentation répétée du dehors, cette évidence toute théorique ne rend pas pour autant sa pratique évidente.
Provoquer la rencontre
Premièrement il faut admettre que l’ici et maintenant qui échoit aux pédagogues dans la rue n’est pas le plus facile, toute personne ayant un tant soit peu voyagé aura constaté par elle-même qu’il est des contrées où les interactions sociales du dehors et du quotidien sont bien plus évidentes, où sans les chercher elles se produisent néanmoins. La France de ce début de XXIe siècle n’offre généralement pas cette facilité, et les techniques numériques et sans-fil ne contribuent pas à l’échange direct, il suffit de penser aux têtes baissées sur les écrans de téléphone, aux écouteurs sur les oreilles dans le bus ou le métro, au visionnage de films sur ordinateur portable dans le train… Et les quelques situations qui prétexteraient la sollicitation du passant, de la personne inconnue, peuvent être facilement contournées par la perche à selfie ou Google Maps. Ces gestes solitaires ne signifient pas le désintérêt de la rencontre, ils viennent juste témoigner que la rencontre n’est pas évidente, non pas forcément qu’on s’en protège mais tout aussi bien qu’on prévient, par ces usages, son absence ou sa faible fréquence : outils numériques et posture narcissique peuvent aussi bien signifier un désir d’être seul qu’une angoisse d’être abandonné. Quoiqu’il en soit, c’est dans ce contexte général qu’agissent les pédagogues du dehors, et il signifie déjà que la rencontre, si elle ne vient pas d’elle-même, devra être provoquée.
Et, en effet, les pédagogues sont des provocateurs de rencontres et d’interactions sur l’espace public : dans les cages d’escalier, les ascenseurs où ils discutent avec les voisins des familles chez qui ils se rendent, dans la rue en profitant de tel ou tel micro-événement : un groupe de percussionnistes est approché, il s’avère que le meneur est prêt à proposer un atelier avec des enfants ; un couple apprend à faire du vélo à son enfant, l’engin est dégonflé, samedi le GRPAS organise un atelier de remise en état de vélos, n’hésitez pas à venir… La joie du dehors n’empêche pas l’appréhension, les pédagogues en parlent souvent, discrètement, rapidement, dans les discussions informelles, dans les journaux de bords que certains tiennent, dans les journées de réflexion organisées pour produire ce livre : il faut oser « aller vers », il faut « dépasser la peur de la rencontre gratuite », il faut « avoir du culot ». Les pédagogues des champs, celles et ceux qui agissent en milieu rural, sur un territoire qu’il faut parcourir en voiture et qui compte plusieurs communes, pratiquent la « présence sociale », manière de prendre la température d’un territoire et des jeunes qui y vivent : il s’agit de rencontrer les jeunes sur les endroits qu’ils fréquentent, place publique, rue, terrain de sport, lieu de baignade, cour ou sortie de collège, etc. Ce qui se passe habituellement pour un public lambda pénétrant dans un lieu clos qu’il ne connaît pas, c’est, en pédagogie sociale, le pédagogue qui le vit : se rendre dans les lieux fréquentés par les jeunes, qu’ils ont fait leur, s’immiscer dans le groupe, espérer son hospitalité. Il y a comme un moment de flottement avant de se lancer, le temps de repérer un visage connu ou de trouver la formule qui expliquera simplement cette venue, ou juste ce moment de respiration nécessaire avant de sauter le pas. Non que le risque soit grand : même lorsque des adolescents connus décident de ne pas faciliter la tâche, cachés derrière une chambre-à-air de tracteur au milieu d’un canal, Adeline les interpelle et leur dit qu’elle est surprise qu’ils ne viennent plus dire bonjour ! La discussion se lance à distance, et les jeunes rejoignent finalement la berge. Sur un terrain de foot quelques jeunes jouent, il faut attendre le moment propice pour s’approcher, interpeler une jeune qui se présente comme la sœur d’un garçon fréquentant de temps en temps le GPAS, les autres joueurs s’approchent, la discussion se lance. Risque faible, mais cette faible intensité, cette espèce d’irradiation douce de la rencontre-qui-ne-va-pas-de-soi, suppose une énergie sans cesse à aller chercher. Partir à la rencontre sans autre chose à posséder qu’une bonne connaissance du territoire, de ses opportunités et de son actualité, n’a rien d’évident, même si, le moment passé, il est facile de dire que ça valait le coup1. Se passer de local contraint à fréquenter le dehors, les avantages sont nombreux et, comme le précise un instituteur de l’école de Trégain, sur le quartier de Maurepas, « plein de famille ne mettront jamais les pieds dans un local ». C’est un fait, et inverser la pratique (ne plus « faire venir » mais « aller vers ») crée une situation singulière : ce ne sont plus aux enfants, aux adolescents et à leur famille de pousser la porte, c’est aux pédagogues qu’il est demandé de prendre ce risque.
Écouter, regarder, se rendre disponible
Deuxièmement, lorsqu’on s’ouvre à l’extérieur, mécaniquement l’extérieur s’ouvre à vous : « Plus on passe de temps dans la rue, les ascenseurs, etc. et plus on est disponible… et plus on discute d’autre chose que dans un local » dit Anaïs ; et Anne-Catherine affirme que son travail de pédagogie sociale commence dès qu’elle passe la porte du petit local, à partir du seuil il s’agit de se rendre disponible à l’événement qui surgit, à la personne qui interpelle. Lorsqu’on s’ouvre à l’extérieur et que l’extérieur s’ouvre à vous, l’étrange et l’étranger deviennent l’ordinaire et le voisin. Joie du dehors mais aussi nouvelle complexité due à cette proximité : l’enfant qui lève le doigt en classe pour participer à une sortie, une fois, deux fois, dix fois… autant de fois où le ou la pédagogue devra aller solliciter l’autorisation des parents, et parfois autant de refus. Au volontarisme qui consiste à provoquer la rencontre avec l’inconnu, s’ajoute la volonté de négocier avec ceux qui ne sont plus tout à fait étrangers, et l’expérience des « petites victoires », expression par laquelle les pédagogues nomment les changements qu’ils ont su générer et qui donnent sens à leur action, leur fait dire que l’énergie dépensée n’est pas vaine. Car le plus souvent, la ténacité du ou de la pédagogue et l’entêtement de l’enfant paient, et c’est autre chose qui commence, une relation avec l’enfant, et donc avec sa famille, un autre possible.
Agir en extérieur indique qu’il faut jouer avec des règles qui ne sont pas celles des pédagogues, et les leurs ils ne pourront pas les imposer ; c’est une des différences avec la logique de l’entre-les-murs. En pédagogie sociale, on est sans cesse invité chez les autres2, il faut s’y adapter. Et lorsqu’un père affirme que, chez lui, les filles ne font pas de vélo, et que malgré la persévérance de l’enfant et le volontarisme de la pédagogue à venir et revenir, à chercher à obtenir une « petite victoire » qui peut changer le cours des choses, rien n’y fait, alors la pédagogue ne peut que respecter cet extérieur ; le ressentiment, l’exaspération auront leur place en réunion de pédagogues.
Une pratique collective
Troisièmement, les contingences de la pratique hors-les-murs ne réservent pas que la joie du dehors. Agir en quartier populaire et vertical ou auprès des solitudes résidentielles du rurbain ouvre à des réalités que les pratiques du dedans peuvent se permettre de ne pas voir : les grands dénuements matériels ou affectifs, la solitude, l’ennui, la mort. Rien n’est simple, comme disent les pédagogues « il faut accepter d’être pris au dépourvu », se coltiner la vie ; l’expérience permet de l’affronter avec les comportements appropriés, sans que cela signifie qu’on se soit habitué à cette face obscure de la vie individuelle et de la vie sociale : appartements vides de meubles, solitudes, dépressions qui demandent une énergie considérable pour garder la tête hors de l’eau, pour ne pas perdre pied, pour pouvoir garder un lien avec ses enfants, expérience de la guerre et souvenirs qui ne s’effacent pas, décès dans un contexte de fragilité et de précarité déjà extrêmes…
Ce volontarisme quotidien que suppose l’ « aller vers », et qui a de quoi ébahir, le fait de tenir le cap d’une navigation en eau parfois agitée tient au sein des GPAS pour deux raisons principales : l’une qui peut être considérée comme négative même s’il permet d’éviter la pétrification des GPAS, c’est la faible durée de vie professionnelle des pédagogue de rue qui perçoivent bien vite qu’ils et elles exercent un métier singulier et à bien des égards palpitant, mais à haut pouvoir d’usure. Les pédagogues se recyclent rapidement, et vers des horizons professionnels souvent lointains. L’autre raison tient à l’organisation des équipes des quatre GPAS et leur mise en réseau : les espaces pour échanger sur les difficultés de l’action hors-les-murs, pour rendre possible le fait de confier ses difficultés, pour créer un filet de sécurité affectif et technique sont nombreux. Il s’agit aussi bien des réunions d’équipes hebdomadaires, des journées de rencontre entre pédagogues des quatre GPAS, mais aussi, au quotidien, de l’attention portée aux autres, qui explique qu’une jeune pédagogue puisse rentrer d’une sortie chaotique et trouver de suite une oreille pour entendre son intranquillité, ses doutes, et pour recevoir des bribes de réponses et d’apaisement. Cette force donnée par la création de multiples espaces d’échange collectif il ne faut absolument pas la négliger, la joie du dehors n’est pas suffisante à la pédagogie sociale, un deuxième ingrédient doit y être ajouté : la pratique du collectif.
1 La pédagogie sociale n’est pas la seule à pratiquer cet « aller vers », pour une approche méthodologique de ce type d’intervention à l’air libre : Pédagogie du développement social, Faire cause commune, J.-L. Graven, A.-C. Berne, P. Nové-Josserant, Chronique sociale, 2008, p. 26-38.
2 Revue Pédagogie sociale, n°5, 1999, p. 5.