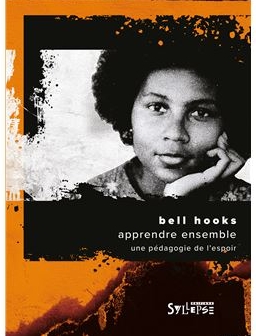Apprendre ensemble, de bell hooks (note de lecture)
Cet ouvrage de bell hooks est plus directement consacré au travail de pédagogue et d’éducateurice. À partir de son expérience de prof de fac, de lectures et d’entretiens, bell hooks structure son propos en 16 leçons au centre desquelles se trouve une pédagogie de l’espoir et de la liberté, illustration de ce que peut être une pédagogie émancipatrice.
Par conséquent, la centralité de la question des dominations dans ce livre ne doit pas nous étonner car c’est contre elles que se lève toute éducation émancipatrice : « La volonté de dominer n’a pas de couleur, écrit bell hooks. Tout·e citoyen·ne d’une culture dominante a été conditionné·e à croire que la domination est la fondation de toute relation humaine » (p.91).
Ainsi, l’autrice propose plusieurs pistes pour construire une pédagogie de l’espoir, qui réinstaure la confiance, la joie d’apprendre, l’esprit critique et la conscientisation :
– la pratique de la liberté contre les structures de domination et autoritaires ;
– une éducation accessible à toustes plutôt que comportant des parties réservées à une élite ;
– la mise en avant de l’espoir et de la confiance en un pouvoir d’agir, contre le désespoir et l’impuissance véhiculées par les médias de masse et parfois nourries par l’école ;
– l’humanité et l’empathie plutôt que la déshumanisation dont nous pouvons faire preuve, lorsque nous ne prenons pas en considération les conditions réelles d’existence des élèves ;
bell hooks rappelle en effet à quel point la manière dont les jeunes ont été conditionné·es influence leur estime d’elleux mêmes et par là leur comportement à l’école, notamment avec la notion de « biais de confirmation » : les jeunes peuvent avoir tendance à confirmer, par leurs choix et attitudes, une opinion préexistante que les adultes ont sur elleux (telle jeune fille serait timorée et silencieuse, tel garçon serait agité et insolent, tel·le élève venant d’une famille pauvre n’irait pas loin à l’école, par exemple). L’autrice rappelle ainsi notre rôle à nous, éducateurices, dans la déconstruction de ces préjugés et la construction d’une estime de soi positive et d’un renforcement de l’autodétermination chez les élèves.
– le respect des différences et la reconnaissance de l’égale importance de toutes les voix, contre les pratiques d’humiliations et de mises à l’écart.
bell hooks évoque en effet la difficulté à dépasser la honte de soi dans laquelle les élèves ont pu être conditionné·es, notamment les jeunes faisant partie d’un groupe marginalisé. Honte par le rejet, par l’humiliation, par l’invisibilisation… Honte qui génère un sentiment d’impuissance et par là la passivité et les blocages lorsque la pédagogie est plus active. Honte qui crée la silenciation ou au contraire la rage.
L’autrice fait un lien extrêmement important à mon sens entre domination et esprit de compétition à l’école, que nous entretenons avec l’organisation de concours, de classement entre les jeunes : « La prédation au cœur de la culture de la domination émerge quand les étudiant·es ressentent le besoin de se détruire symboliquement les un·es les autres afin de prouver qu’iels sont les plus intelligent·es. Bien que les élèves arrivent à l’université avec des capacités et des compétences similaires, personne ne part du principe que la salle de cours sera ce lieu commun où ces compétences mèneront à une excellence globale de la part de toustes les élèves. La compétition, enracinée dans des pratiques déshumanisantes d’humiliation, des rituels de pouvoir sadomasochistes, écarte toute possibilité de mise en commun, et entrave la création d’une communauté. […] Plutôt que de s’envisager les un·es les autres comme camarades, les élèves apprennent à se percevoir comme des adversaires, luttant pour le prix d’être le ou la plus intelligent·e et de pouvoir ainsi dominer les autres » (p.142-3).
– l’éducation au service des étudiant·es et non leur soumission aux désirs des adultes : « l’éducateur·rice qui se met au service des autresaffirme continuellement, par sa pratique, qu’éduquer les étudiant·es est le seul vrai objectif, et non pas l’autoglorification ou l’affirmation d’un pouvoir personnel. La pédagogie conventionnelle crée souvent un contexte où l’élève existe en cours pour servir la volonté du ou de la professeur·e, comblant ses besoins, que ce soit le besoin d’un public, le besoin d’entendre de nouvelles idées pour stimuler son travail intellectuel, ou même le besoin d’affirmer sa domination sur des étudiant·es soumis·es. C’est cette tradition d’exploitation que le·la professeur·e soucieux·euse cherche à remettre en question et à transformer. Un engagement à servir pousse l’enseignant·es à devoir rendre des comptes quant à l’éthique en cours. Le soin et le service ont un impact sur la gestion des conduites en cours. […] L’enseignant·e capable de demander « de quoi avez-vous besoin pour apprendre ? » ou « à quoi puis-je servir ? » apporte au travail éducatif un esprit d’assistance qui fait honneur à la volonté des élèves d’apprendre. Se soucier de manière engagée transmet aux élèves que le principe de l’éducation n’est pas de dominer ou de les formes à dominer, mais plutôt de créer les conditions de la liberté » (p.104-5).
Hormis ces différents principes qui permettent de réhumaniser notre travail, dans un contexte où l’on nous impose toujours plus d’évaluations normées et normantes, plus de programmes rigides et fermés, un chapitre mérite d’être mis en avant : il s’agit de la deuxième leçon, au cours de laquelle l’autrice évoque le burn out, sujet encore trop peu abordé dans notre milieu, avec ses conséquences délétères sur le travail comme sur les relations avec les élèves. Elle explique comment sa propre expérience du burn out l’a poussée à s’extraire de sa profession pour retrouver de l’air et de l’espoir.
Avec cette phrase qui touche au cœur, lorsqu’on y a été confronté·e aussi : « cela exige du courage de n’importe quel·le enseignant·e enthousiaste d’accepter et de réagir aux périodes de burn out, et de s’abandonner au chagrin de la perte et de la séparation » (p.37).
Pour conclure, je finirais cette note de lecture par une citation de l’introduction écrite par bell hooks, qui définit la pédagogie de l’espoir et peut illuminer notre quotidien :
« Ces vingt dernières années, les éducateur·rices qui osèrent s’instruire et apprendre de nouvelles manières de penser et d’enseigner de sorte que notre travail ne contribue pas à renforcer des systèmes de domination, d’impérialisme, de sexiste et d’élitisme de classe ont créé une pédagogie de l’espoir. Parlant du besoin de cultiver l’espoir, l’éducateur brésilien Paulo Freire nous rappelle : « La lutte pour l’espoir implique la dénonciation, en termes non équivoques, de tous les abus… Alors que nous les dénonçons, nous réveillons chez les autres, et chez nous-mêmes, le goût de l’espoir. » Mon espoir naît de ces lieux de luttes où je suis témoin de la transformation par des individus de leur monde et de leur vie. Éduquer est toujours une vocation ancrée dans l’espoir. En tant qu’enseignant·es, nous sommes persuadé·es que l’apprentissage est possible, et que rien ne peut empêcher un esprit curieux de poursuivre une quête de la connaissance, et de trouver des moyens de connaître. » (p.16)
Jacqueline Triguel (Questions de classe(s), SUD éducation 78)