Deux ouvrages portant sur les « pédagogies alternatives » viennent d’être publiés à deux mois d’intervalle, l’un en France, l’autre en Espagne1. La coïncidence n’est pas vraiment surprenante à une époque où les écoles alternatives fleurissent un peu partout, en France, en Espagne et ailleurs, et où -comme le montrent les deux auteurs- ces pratiques alternatives sont de plus en plus solubles dans le néolibéralisme. Ce n’est pas la première fois que ce sont publiés -en tout cas en France- des ouvrages portant sur ces pédagogies (on pense par exemple aux livres publiés par Marie-Laure Viaud et Sylvain Wagnon) mais cette fois les auteurs s’attachent davantage à en souligner les dérives et à mettre l’accent sur les points de vigilance.
Des analyses qui dérangent
Les deux auteurs partent d’un angle différent (Ghislain Leroy est spécialiste de l’école maternelle tandis qu’Ani Pérez est issue des pédagogies libertaires) pour interroger finalement certains présupposés identiques comme par exemple l’autonomie des élèves qui serait forcément un objectif à atteindre ou l’interventionnisme du professeur qu’il faudrait limiter… Leur définition des « pédagogies alternatives » est assez proche, ils les définissent comme toutes les pratiques qui se distinguent de la pédagogie « traditionnelle ». Ghislain Leroy englobe dans cette dénomination toutes les pédagogies nées du courant de l’Éducation nouvelle alors qu’Ani Pérez s’intéresse davantage à l’histoire des pédagogies libertaires. Ces définitions très larges ne rendent pas toujours le propos très clair tant il y a de différence entre une école Montessori, une classe Freinet ou une école Sudbury. Il faut reconnaître aussi que leurs réflexions dérangent parfois les militants que nous sommes quand la pédagogie Freinet ou les pratiques autogestionnaires ne sont pas épargnées. D’ailleurs Ani Pérez est souvent prise à partie sur les réseaux sociaux depuis qu’elle critique les « écoles libres » qui selon elle seraient bien plus libérales que libertaires. Lorsqu’on milite pour une autre école on est exposé à de nombreuses attaques de la part des partisans de l’école « traditionnelle », cela nous rend particulièrement sensible aux critiques, cette sensibilité peut devenir susceptibilité et nous faire oublier qu’une pédagogie qui n’accepte pas le débat est une pédagogie morte.
Une critique de la non-directivité
Ghislain Leroy et Ani Pérez soulignent tous les deux les limites de la non-directivité. Ce courant, initié par Carl Rogers, un psychologue américain, a inspiré de nombreux pédagogues dans les années 60-80. La non-directivité a facilement pénétré les milieux pédagogiques alternatifs car elle allait dans le même sens que la philosophie qui a imprégné tout le courant de l’Éducation nouvelle mais également de l’éducation libertaire. Selon certains -on pense par exemple à une analyse de Carlos Lerena, un sociologue espagnol qui a publié ses principaux ouvrages dans les années 802– la pédagogie occidentale serait foncièrement idéaliste, l’enfant y est vu comme un être innocent et naturellement curieux, l’éducateur doit donc se borner à faire éclore ses capacités en intervenant le moins possible puisque toute intervention pourrait entraver le processus. C’est ce qui expliquerait que ces pédagogies donnent autant d’importance aux intérêts naturels des enfants (notamment chez Decroly et Freinet) ou distinguent des stades de développement qu’il faudrait respecter (comme chez Montessori).
Pourtant cette non-directivité n’est pas sans risque. Ghislain Leroy s’appuie sur la sociologie et Ani Pérez sur des penseurs marxistes comme George Snyders pour nous mettre en garde. La sociologie nous alerte sur l’erreur qui consiste à croire que les intérêts des enfants seraient naturels quand ils seraient en réalité socialement situés. Dès lors, croire qu’une classe où l’enseignant interviendrait le moins possible serait véritablement démocratique est un leurre. C’est ainsi que les écoles Sudbury, autrement appelées « écoles démocratiques » où « les enfants sont censés apprendre quand ils veulent, comme ils veulent et avec qui ils veulent » ne feraient finalement qu’accentuer les inégalités car « la démocratie et la liberté décrétées dans le programme Sudbury [profitent] d’abord aux participants déjà réflexifs, d’emblée autonomes dans l’apprentissage et dominants dans les discussions ».3 De son côté Ani Pérez cite George Snyders et son livre Où vont les pédagogies non directives ? pour démontrer que les pédagogies libertaires qui se sont inspirées de la « non-directivité » ont fait fausse route. Elle rappelle qu’il existe deux courants dans ces pédagogies, l’une qui promeut -dans la lignée de Ricardo Mella4– la neutralité (il ne faut pas influencer les enfants et l’objectif n’est pas d’en faire des anarchistes) et l’autre courant qu’elle nomme « socio-politique » qui s’accommode de certaines formes d’interventionnisme surtout lorsqu’il est question de déconstruire certaines représentations véhiculées par la société qu’on souhaite transformer. C’est donc le courant issu de la neutralité préconisée par Ricardo Mella (à l’opposé d’un Francisco Ferrer) qui s’est le plus nourri de la pensée de Carl Rogers. Pourtant l’objectif démocratique affiché n’est pas atteint : « l’omission du professeur n’est pas une attitude démocratique mais une action conservatrice déguisée sous l’apparence du respect humain ».5 En effet Ani Pérez souligne que cette pédagogie « non directive » n’est rien d’autre que « l’acceptation de la reproduction héréditaire des hiérarchies sociales comme s’il s’agissait d’un désir spontané ou d’un choix libre ».
Au-delà de la question des écoles Sudbury (et par extension de certaines écoles libertaires privées) tant Ghislain Leroy qu’Ani Pérez font référence au concept de « pédagogie invisible » développé par Basil Bernstein pour critiquer certaines pratiques pédagogiques présentes dans l’école publique. En effet les pédagogies du projet et plus largement les « pédagogies socio-constructivistes » (cette formulation de Ghislain Leroy pose problème car il n’existe pas de « méthode » socio-constructiviste en éducation, c’est simplement un champ de réflexion en sciences de l’éducation) peuvent engendrer des inégalités car elles reposent sur une connivence entre culture familiale et culture scolaire qui n’existe que dans les milieux plutôt favorisés (dont sont souvent issus les enseignants). Ainsi les enfants de milieux populaires ne comprendraient pas forcément les enjeux des tâches scolaires lorsque ceux-ci ne sont pas assez explicites (Bourdieu parlait de « pédagogie rationnelle »), il faudrait donc rendre visibles, autrement dit explicites, ces enjeux afin de ne pas creuser les inégalités. Nous aurions trop tendance à croire que les projets bénéficient à tous les élèves en augmentant leur motivation alors qu’il s’agit trop souvent selon Ghislain Leroy d’une « pédagogie du détour ».
Et la pédagogie Freinet ?
Après ces différentes mises en garde nous pouvons nous demander comment les deux auteurs perçoivent la pédagogie Freinet. Tous les deux sont d’accord pour souligner la place particulière de la pédagogie Freinet dans cette galaxie qu’ils nomment « pédagogies alternatives » tout en associant la figure de Freinet à celle de Freire. Ani Pérez évoque Freire en même temps que Freinet en les désignant tous les deux comme des « militants politiques engagés pour la justice sociale ». Ghislain Leroy consacre plusieurs pages de son livre aux pédagogies critiques et considère que Freire aurait « repris le flambeau de la résistance » autrefois porté par Freinet. Ani Pérez cite longuement Freinet quand il critique la naïveté de l’idéalisme de Rousseau, elle le distingue donc des autres pédagogues de l’Education nouvelle.
Pourtant les deux auteurs s’interrogent sur le bien-fondé des pédagogies qui prétendent s’appuyer sur les intérêts naturels des enfants. Ghislain Leroy se demande donc si la pédagogie Freinet est en mesure d’aider les enfants des milieux populaires, il cite pour cela l’étude d’Yves Reuter à l’école Freinet de Mons-en-Barœul. Si la recherche d’Yves Reuter a montré des bienfaits de cette pédagogie, Jean-Pierre Terrail dans un autre article (cité par Leroy) a émis des réserves notamment sur les recherches mathématiques basées sur « l’inventivité des élèves » et le lâcher prise des enseignants qui selon lui « laisse perplexe ». Ani Pérez de son côté cite abondamment George Snyders dans son livre ; or Snyders est l’universitaire qui en 1950 a déclenché une telle polémique contre le mouvement Freinet (l’accusant d’être une pédagogie bourgeoise) que celui-ci a eu du mal à s’en remettre. Snyders reconnaîtra d’ailleurs de nombreuses années plus tard qu’il connaissait mal la pédagogie Freinet à l’époque.
Le monde universitaire peut donc avoir du mal à appréhender la pédagogie Freinet qui semble synonyme pour certains de spontanéisme et d’abandon des élèves aux déterminismes sociaux. C’est mal connaître la pédagogie Freinet qui ne laisse pas les enfants livrés à eux-mêmes mais qui assume pleinement la nécessité d’une intervention éducative. La pédagogie Freinet n’est pas « non directive » mais est toujours en tension entre une nécessaire « dévolution » de l’activité d’apprentissage à l’enfant et la « part du maître ». Ainsi il ne suffit pas de partir de la curiosité des enfants, il faut problématiser leurs interrogations au regard du monde qui nous entoure, en s’appuyant sur des ressources que l’on convoquera au fur et à mesure que les questions émergent. C’est ce que font les enseignants Freinet qui ont une longue expérience et qui se sont formés tout au long de leur carrière dans les stages et les congrès proposés par l’ICEM.
S’il est facile pour certains universitaires de tomber dans la caricature, il ne faudrait pas non plus que les enseignants qui se réclament de la pédagogie Freinet fassent fausse route par naïveté. Une certaine fascination pour le spontanéisme enfantin peut animer certains enseignants Freinet et on lit parfois dans les revues du mouvement des articles qui vantent la curiosité naturelle des enfants, oubliant que celle-ci est une construction sociale. Le risque est grand si on n’y prête pas attention de renforcer les déterminismes sociaux alors même qu’on vise une émancipation des enfants.
C’est parce que ces deux ouvrages mettent le doigt sur certains impensés des mouvements pédagogiques qu’ils dérangent, mais c’est bien pour cela que leur lecture est essentielle.
Cécile Morzadec
1. Il s’agit de Las falsas alternativas d’Ani Pérez Rueda publié en mars 2022 et de Sociologie des pédagogies alternatives de Ghislain Leroy publié en mai 2022.
2. Carlos Lerena, Escuela, ideología y clases sociales en España, 1989. Carlos Lerena démontre que l’éducation occidentale repose sur deux mythes, « le mythe socratique de l’éducation non directive » et « le mythe rousseauiste de l’éducation naturelle ».
3. Ghislain Leroy cite une étude d’Olivier Maulini publiée en 2017 et intitulée « Que penser de la pédagogie de Sudbury ? »
4. Ricardo Mella (1861-1925), pédagogue anarchiste, considérait qu’il ne fallait pas influencer les enfants en leur inculquant des idées politiques fussent-elles anarchistes, il voulait une « école neutre » et pour lui le modèle de « l’école moderne » de Francisco Ferrer était dogmatique.
5. Ani Pérez cite un ouvrage de Moacir Gadotti publié en 2003, intitulé Histoire des idées pédagogiques.


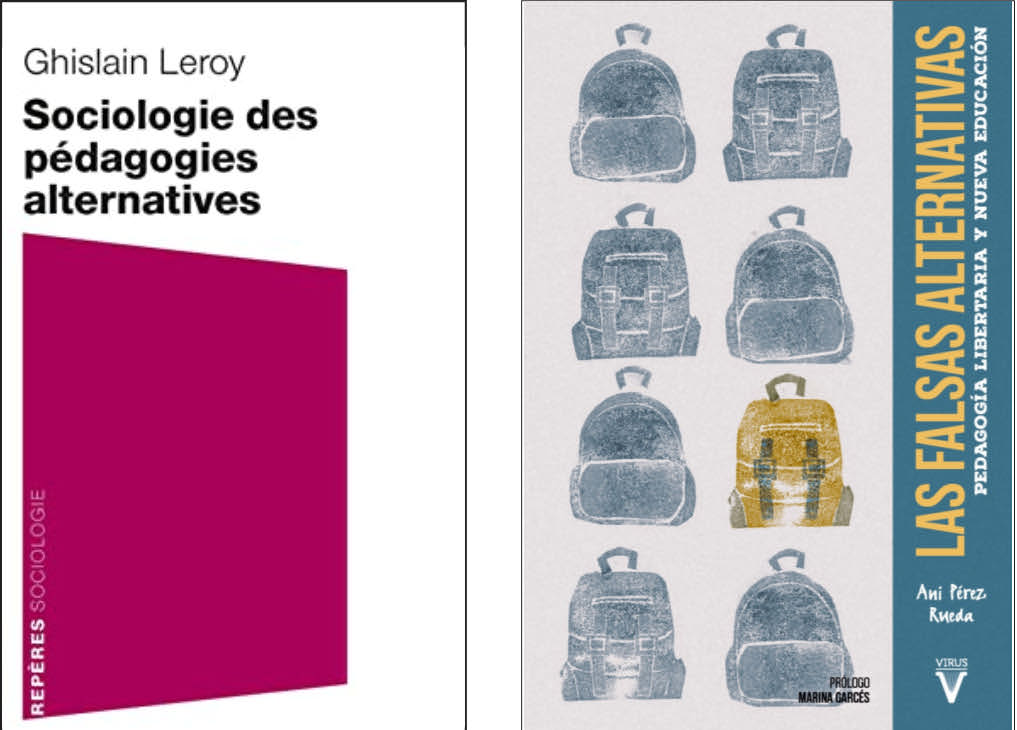
Ping :Juin – Jeunesse/Éducation | Revue de presse Emancipation