Rencontre avec Laurence De Cock à la librairie Libertalia
Montreuil, samedi 25 septembre, 19 h 30.
Le collectif Questions de classe(s) accueille Laurence De Cock à l’occasion de la publication d’École publique et émancipation sociale (Agone).
À la librairie Libertalia, 12 rue Marcelin-Berthelot, 93100 Montreuil (métro Croix-de-Chavaux).
Enseignante en lycée et chargée de cours en histoire et sociologie de l’éducation à l’Université de Paris, Laurence De Cock est notamment l’autrice d’École (Anamosa, 2019), Dans la classe de l’homme blanc. L’enseignement du fait colonial des années 1980 à nos jours (PUL, 2018) et de Sur l’enseignement de l’histoire. Débats, programmes et pratiques de la fin du XIX e siècle à nos jours (Libertalia, 2018) . Aux éditions Agone, co-autrice de L’Histoire comme émancipation (avec Guillaume Mazeau et Mathilde Larrère, 2019) elle a codirigé les deux volumes de La Fabrique scolaire de l’histoire (2009, 2017) et Les Pédagogies critiques (2019) ; et elle fait paraître École publique et émancipation sociale en août 2021.
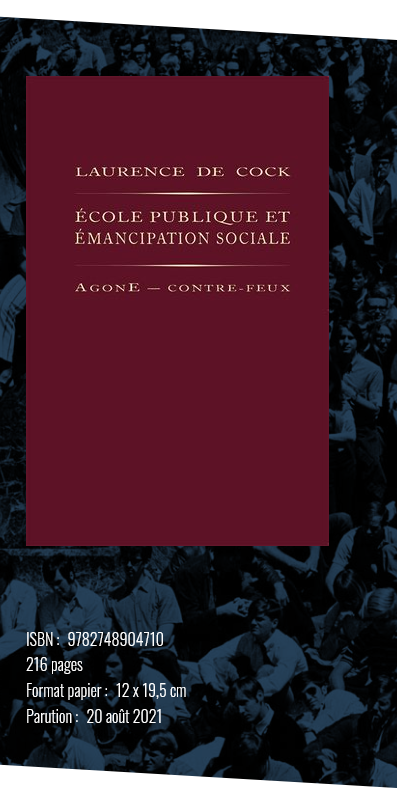 L’école publique comme laboratoire pour l’émancipation sociale de toutes et tous
L’école publique comme laboratoire pour l’émancipation sociale de toutes et tous
Extrait de l’introduction et la conclusion d’École publique et émancipation sociale, qui vient de paraître aux éditions Agone, coll. « Contre-feux »
Alors que l’école publique est plus fragile que jamais, fruit de trente ans de réformes, de droite comme de gauche, le régime du ministère Blanquer sous Covid révèle la profondeur de la crise. Ce livre remonte aux fondamentaux d’un projet qui prend source dans la Révolution française, se réaffirme au temps de la Commune de Paris puis de Juin 36 et des réformes de 1947 nourries des acquis de l’éducation nouvelle. Mais entre les faux amis des « pédagogies alternatives » et les assauts du néolibéralisme, la voie est étroite, pourtant indispensable, pour faire renaître un projet d’émancipation sociale de toutes et tous.
En 1971, dans un singulier conte pour enfants, Ah ! Ernesto, Marguerite Duras raconte l’histoire d’un petit garçon qui manifeste son désir de ne plus aller à l’école car il ne veut pas qu’on lui apprenne des choses qu’il ne sait pas. Démunis, ses parents rencontrent le maître, qui s’arrache les cheveux sur ce cas. Finalement, Ernesto lâche le morceau : pas besoin d’école, il apprendra tout ce dont il a besoin « par la force des choses ».
Un an auparavant, dans un registre tout autre, paraissait La Reproduction. Éléments pour une théorie du système d’enseignement, de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, l’une des premières études de sociologie de l’éducation à montrer, en France, chiffres à l’appui, le mécanisme de reproduction des inégalités sociales par le biais de l’école.
À leur manière, chacun des deux livres opère une critique radicale de l’école publique. Le contexte historique y est particulièrement favorable. Dans la foulée de Mai 68, en pleine massification scolaire, les attaques contre une institution soupçonnée d’être l’antichambre du maintien de l’ordre social dominant sont légion.
L’école est « bloquée », diagnostique l’historienne et enseignante Suzanne Citron, dans son tout premier livre, en 1971 [1] . Il faut la refonder sur de nouvelles bases, plus pédagogiques, plus démocratiques aussi. Il est vrai qu’à cette date la question de l’école unique, commune, pour tous les enfants, n’est pas réglée, loin s’en faut. Des filières parallèles continuent d’exister dans le privé pour les familles privilégiées mais aussi dans le public avec un tri social au niveau de l’entrée du collège à l’âge de 11 ans.
Tandis que certains s’attachent à penser la réforme en réfléchissant à des pédagogies « nouvelles », « actives » et à de nouvelles formes scolaires, d’autres se laissent fasciner par la rupture totale avec le système. Libres enfants de Summerhill, le best-seller d’Alexander Neill, paraît en France en 1970, dix ans après sa première publication à New York : il relate la création d’une école, en Angleterre, où est laissé aux enfants un libre choix absolu dans leur emploi du temps comme dans leurs modalités de travail ou de non-travail [2] . Autre succès un an plus tard, l’ouvrage d’Ivan Illich, Une société sans école, dans lequel l’auteur, philosophe et ancien prêtre, plaide, non pas pour supprimer les lieux de transmissions de savoirs (comme il est souvent dit), mais pour leur « déscolarisation », c’est-à-dire l’abolition de la dimension institutionnelle de l’école et son remplacement par un système de « réseaux de savoirs » [3] .
Ces critiques plus ou moins radicales ne procèdent pas vraiment des mêmes logiques et ne s’amalgament pas si facilement. Mais les années 1970 sont bien une véritable fenêtre d’opportunité pour penser et réparer une école dont tout le monde s’accorde déjà à dire qu’elle dysfonctionne au regard de sa mission d’accompagnement des enfants vers l’émancipation sociale.
Un demi-siècle plus tard, si de nouvelles questions sont posées à l’école depuis que le néolibéralisme s’y attaque, comme à tout ce qui relève du service public, les anciens problèmes sont loin d’avoir disparu. Mais les solutions proposées aujourd’hui sont, pour l’essentiel, portées par une frange réactionnaire qui argue de l’« échec » des alternatives post-soixante-huitardes. Le piège se referme peu à peu sur une école sommée de reconnaître la faillite des théories sociologiques, pédagogiques et émancipatrices qui ont longtemps nourri sa critique et, en partie, ses réformes.
Emportée, comme les autres institutions, par la vague néoconservatrice, l’école publique peine à faire valoir aux yeux d’une opinion désabusée qu’elle n’a rien à gagner à sacrifier toute perspective d’émancipation sociale à la logique de réussite individuelle des élèves et de tri précoce conforme aux attentes d’une société soumise à la logique de marché.
Les défis sont alors gigantesques : acter les erreurs passées, lutter contre la ringardisation de toute pensée de l’émancipation et continuer de défendre le principe d’une école commune comme condition de la démocratisation scolaire alors qu’elle n’a jamais rempli ses objectifs. Et les troupes sont faibles. Il faut dire que la mission est difficile à plaider : réparer la boussole de l’école publique tout en admettant que, si la destination est connue, on ignore presque tout du chemin, sinon qu’il s’annonce très accidenté.
Tout le monde n’a pas l’esprit d’aventure. Et il est beaucoup plus simple de s’en remettre paresseusement aux kits de réussite proposés par des gouvernements essentiellement soucieux de faire correspondre le temps de la réforme de l’école à leur calendrier politicien. Mais rien ne sera possible si nous nous en remettons aveuglément aux vertus de la délégation. C’est sur la société tout entière que repose la responsabilité de porter un projet scolaire. À cet égard, et puisque celles et ceux qui œuvrent pour un projet égalitaire de transformation sociale semblent aujourd’hui cantonnés à une position défensive, peut-être est-ce le bon moment de se compter, de reprendre la main et de revitaliser le principe d’une école publique, de masse, au service de l’émancipation sociale.
Comme nombre de mots galvaudés, celui d’« émancipation » est aujourd’hui récupéré jusque chez les néolibéraux. L’émancipation devient alors la libre entreprise de soi, à la manière d’un entrepreneuriat permettant de sortir de sa condition sociale par l’effort et le mérite. On n’est plus que le pionnier de son ascension sociale, de sa « réussite ». Rien d’étonnant à ce que le ministre de l’Éducation du gouvernement d’Emmanuel Macron soit le premier promoteur de cette redéfinition [4] . Il va de soi que cette « émancipation » n’implique aucun changement de l’ordre social puisqu’il ne s’agit, pour chacune et chacun, que de s’en sortir le mieux possible dans le monde tel qu’il est.
Une véritable émancipation ne s’en tient pas à cette définition réductrice. Elle suppose une conscientisation des rapports de domination responsables de l’aliénation, suivie d’un travail collectif pour en abolir les fondements. L’émancipation sociale, comme individuelle, fait le pari de l’utilité du collectif, non comme cadre d’émulation par la concurrence, mais pour construire une coopération guidée par l’impératif de justice sociale et donc au service de celles et ceux qui en ont le plus besoin. De ceci naîtra une société plus juste, où l’idéal ne sera plus de s’élever au-dessus de la mêlée mais de privilégier le commun en supprimant les dominations. Une transformation sociale radicale, en quelque sorte. L’école a un rôle à tenir dans ce vaste projet.
À sa mère et à son instituteur qui lui montrent un papillon orange et bleu épinglé dans sa boîte vitrée en lui demandant de quoi il s’agit, Ernesto, le petit garçon du conte de Marguerite Duras, répond : « C’est un crime ! » Cette sublimation poétique du génie incompris de l’enfance camoufle une autre réalité. Dans le monde tel qu’il est, voilà à quoi ressemblerait plutôt le dialogue d’un enseignant avec un condisciple d’Ernesto :
— Et ça qu’est-ce que c’est ?
— Un papillon.
— Peux-tu nous le décrire ?
— C’est un vrai papillon ? Pourquoi ils l’ont mis dans une boîte ?
— Pour l’étudier.
— Ils l’ont tué. Ça se fait pas.
Et le dialogue ne s’arrêtera sans doute pas là. Car le maître ou la maîtresse poserait de nouvelles questions en ramenant l’enfant sur le terrain de l’observation scientifique pour guider son regard et l’éloigner de sa réaction émotive et morale. Mieux encore, l’enseignant aura sans doute commencé sa séance en annonçant aux enfants qu’ils allaient étudier les papillons. Parce que l’enfant sait où on veut le mener, le dialogue sera certainement très différent.
C’est tout le travail de la pédagogie : accompagner en posant des questions, qui jalonnent un parcours de connaissance. Car tous les enfants n’ont pas le privilège d’être capables de se passer d’étapes intermédiaires. C’est à ceux-là que s’adresse en priorité l’école publique. Non qu’elle doive se désintéresser des enfants socialement et culturellement mieux dotés, mais la démocratisation scolaire est une responsabilité collective. Aucune école commune n’est possible sans le consentement et la participation active des familles qui en ont le moins besoin. L’émancipation sociale ne sera possible que lorsque tout le monde aura compris qu’il y a intérêt. Il va de soi qu’il s’agit d’un projet politique global dont l’école n’est que l’un des vecteurs. À l’évidence, isolée dans un environnement hostile, l’école ne pourra jamais réaliser sa démocratisation. Est-ce une raison pour ne pas en poser les fondations ? Et rêver qu’elle fonctionne comme butte-témoin des transformations sociales à venir ?
L’urgence est à la repolitisation de l’école par la gauche de transformation sociale, qui doit ostensiblement se démarquer de tout ce qui contribue à la disqualification de l’école publique. L’heure est plus que jamais à la résistance. C’est l’enseignement que le pédagogue Philippe Meirieu tire de l’ensemble de sa carrière et son œuvre : riposter et contre-attaquer en rappelant que la pédagogie s’est aussi forgée sur « le devoir de résister » [5] .
Résistons donc. En commençant par rappeler que le caractère public de l’école n’implique pas une adhésion béate à un modèle républicain catéchisé mais exige plutôt une répartition et une redistribution des richesses indexées aux besoins et aux profils sociaux de tous les enfants et adolescents présents sur le sol français. En rappelant que le droit à l’école est sans conditions.
Résistons à une médiatisation de l’école focalisée (à raison) sur ses défaillances mais qui ne brandit, pour y remédier, que les figures totémiques de « ces profs qui vont changer l’école » et les discours indigents des professionnels des plateaux TV. L’école ne semble plus être autorisée à parler dans l’espace public que par la bouche de celles et ceux qui l’ont désertée depuis longtemps ou qui l’utilisent comme un plan de carrière. On ne compte plus les « sauvetages » de l’école par un héros ou une héroïne qui, comme Céline Alvarez, disparaît des radars quelques mois plus tard – preuve, s’il en est, qu’enseigner est d’abord un travail collectif.
Résistons aussi aux calomnies récurrentes contre les « privilèges » du métier d’enseignant ou à l’encontre des enfants et des parents accusés de ne jamais être suffisamment intégrés. Résistons aux saboteurs du service public qui cachent leur appât du gain et leur carriérisme derrière des déclarations hypocrites sur leur attachement à une école dont ils sont les fossoyeurs.
Toutes et tous, parents ou non et enseignants de tous statuts, nous devons relever le défi d’une école publique dans laquelle s’expérimentent conjointement des situations sociales égalitaires, solidaires, anti-autoritaires. Une école commune capable de transmettre des savoirs non hiérarchisés, où la compréhension du fonctionnement d’un moteur à explosion, de la construction d’un mur en pierre ou d’une pièce de Molière et d’un roman de Leïla Sebbar auront une saveur équivalente. Une école démocratique s’étant réinventé une langue ne devant rien à l’entrepreneuriat, libérée de la course à la réussite et de la tyrannie du mérite, du poids du classement et de la perpétuelle évaluation.
Enfin, résistons en prenant la parole sur la réalité de notre métier, sur ses difficultés, sur nos tâtonnements, nos plantages et sur les parenthèses enchantées, ces « étincelles pédagogiques » dont parle si bien Jacqueline Triguel, pudiquement, mais avec colère et conviction, contre une institution de plus en plus maltraitante mais pour des enfants et des adolescents dont l’avenir incertain nous oblige à ne pas flancher [6] . Dans une interview, la romancière et enseignante Nathalie Quintane répondait à une question sur son métier : « Si je suis restée en collège, c’est que le tri des élèves n’a pas encore été totalement fait. Donc je peux avoir tous les enfants. Et j’ai tous les jours envie de les retrouver. J’aime essayer de travailler avec eux. Je fais ce métier pour les élèves [7] . » Voilà, retrouvons ce désir d’accueillir tous les enfants.
Laurence De Cock
Notes
- 1.
Suzanne Citron, L’École bloquée, Bordas, 1971.
- 2.
Alexander Neill, Libres enfants de Summerhill, Maspero, 1970.
- 3.
Ivan Illich, Une société sans école, Seuil, 1971.
- 4.
Jean-Michel Blanquer, « L’émancipation », Conférence LREM, YouTube, 23 octobre 2018.
- 5.
Philippe Meirieu, La Riposte. Pour en finir avec les miroirs aux alouettes (Autrement, 2018) et Pédagogie : le devoir de résister (ESF éditeur, 2008).
- 6.
Jacqueline Triguel, Étincelles pédagogiques, Libertalia, 2021.
- 7.
Nathalie Quintane, « Un hamster à l’école », Cafepedagogique.net, 29 janvier 2021.
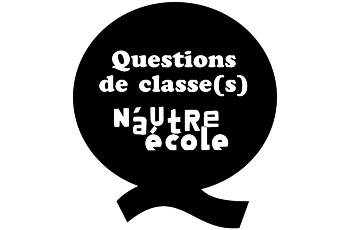



Bonjour,
Pouvons nous espérer que cette rencontre sera accessible à distance et / ou enregistrée ?? pour nous, pauvres, qui habitons la province…