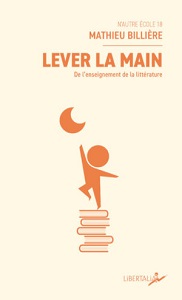[bonnes feuilles] La fabrique des lecteur·ices
Notre collection N’autre école chez Libertalia a un nouveau titre depuis cet été : Lever la main – Vers un atelier autogéré de littérature en classe de français, par Mathieu Billière.
L’enseignant·e de lettres est à la croisée d’un paradoxe : comment,d ans un cadre programmé par les épreuves finales, donner aux élèves une expérience d’émancipation ?
Voici un extrait sur la Fabrique des lecteur·ices (p.89-94), pour vous donner un aperçu d’autres pratiques pédagogiques.
« La fabrique des lecteur·ices
Tu développes l’atelier dès ton premier cours : il y a une commande, en gros les exercices académiques ; il y a du matériau, les textes. Donc distribuer un texte, laisser aux élèves le temps de le lire, puis, après la prise de contact, prendre les remarques comme elles viennent. Toute remarque, dans n’importe quel ordre, est bienvenue. Tu le signales à tes élèves d’emblée. Ce n’est pas facile, pour un·e élève de prendre soudain la parole, librement, sur un texte, pour en dire à peu près ce qu’on veut. C’est même la partie la plus difficile de l’exercice, et tu te souviens de longs silences, que tu as laissé planer. Bien souvent, ces silences s’achèvent par la même timide interrogation :
– C’est quoi la question ?
– Ben justement il n’y en a pas : il faudrait que vous me disiez ce qui vous passe par la tête quand vous lisez ce texte.
Une autre situation fréquente, c’est tel·le élève qui commence à peine à lever le doigt puis qui le rabaisse de suite. Tu lui sautes dessus (c’est une image, hein) : « dis ce que tu as à dire, vas-y. » Vient alors une gêne chez l’élève, qui a peur d’avoir faux, de se tromper, selon la formule consacrée. C’est à toi alors d’expliquer qu’il n’y a, par définition, pas de bonne ou de mauvaise réponse, que précisément ce que tu attends est tout sauf évaluable, ce qu’il nous faut à ce stade, c’est de la matière brute. Forcément c’est un long travail de mise en confiance, contrairement aux paperolles, les élèves ne sont pas protégées par le collectif et l’anonymat. Ça implique de créer un climat de classe qui autorise les élèves à se risquer.
Ça prend du temps, à l’échelle de la séance, de la période, de l’année. Mais le plus souvent ça finit par prendre, en prenant toujours en compte ce qui se dit, tu arrives à créer un climat suffisamment posé pour que les élèves se sentent en mesure de livrer des remarques, des propositions. Peu à peu, à force de pratiques, tu as même réussi à théoriser à peu près comment ça se passe. Dans un premier temps, le moment difficile, les élèves sont en fait obnubilés par la forme scolaire : je suis en classe, le professeur fait cours et attend de moi des remarques pertinentes, je rentre chez moi, j’apprends et je fais les exercices. Arriver dans une nouvelle classe, un nouveau niveau, voire un nouvel établissement, ce n’est déjà pas simple, alors se faire déranger dans une forme de confort routinier par ce professeur qu’on voit pour la deuxième ou troisième fois, ça peut mettre mal à l’aise, ça peut renforcer la recherche du refuge. Tu le sais, tu passes outre. La technique que tu as fini par adopter, c’est de commencer par des textes un peu provocateurs, susceptibles de faire réagir plus vite : la scène du poumon dans Le Malade imaginaire, « Une charogne » de Baudelaire, la scène du meurtre de la mère dans Roberto Zucco, etc. Tu as même fait lire un roman de Houellebecq à une classe un peu endormie. Tu sais ce que ça déclenchera. Tu sais même que parfois, il te faudra défendre ton choix, peu importe, l’essentiel, c’est que ça parle.
En fait tu pratiques une forme de provocation qui consiste à décevoir les horizons d’attente, du texte, du cours. Par exemple, tu demandes aux élèves de décrire une scène de demande en mariage. On finit toujours par construire le canevas qui apparaît dans les productions américaines : le lieu exceptionnel, la bague, le garçon à genoux, etc. Après, tu distribues un extrait de Pierre et Jean de Maupassant, celui-ci :
Elle était adroite et rusée, ayant la main souple et le flair de chasseur qu’il fallait. Presque à chaque coup, elle ramenait des bêtes trompées et surprises par la lenteur ingénieuse de sa poursuite.
Jean maintenant ne trouvait rien, mais il la suivait pas à pas, il la frôlait, se penchait sur elle, simulait un grand désespoir de sa maladresse, voulait apprendre.
— Oh ! montrez-moi, disait-il, montrez-moi !
Puis, comme leurs deux visages se reflétaient, l’un contre l’autre, dans l’eau si claire dont les plantes noires du fond faisaient une glace limpide, Jean souriait à cette tête voisine qui le regardait d’en bas, et parfois, du bout des doigts, lui jetait un baiser qui semblait tomber dessus.
— Ah ! que vous êtes ennuyeux, disait la jeune femme ; mon cher, il ne faut jamais faire deux choses à la fois.
Il répondit :
— Je n’en fais qu’une. Je vous aime.
Elle se redressa, et d’un ton sérieux :
— Voyons, qu’est-ce qui vous prend depuis dix minutes, avez-vous perdu la tête ?
— Non, je n’ai pas perdu la tête. Je vous aime, et j’ose, enfin, vous le dire.
Ils étaient debout maintenant dans la mare salée qui les mouillait jusqu’aux mollets, et les mains ruisselantes appuyées sur leurs filets, ils se regardaient au fond des yeux.
Elle reprit, d’un ton plaisant et contrarié :
— Que vous êtes malavisé de me parler de ça en ce moment ! Ne pouviez-vous attendre un autre jour et ne pas me gâter ma pêche ?
Il murmura :
— Pardon, mais je ne pouvais plus me taire. Je vous aime depuis longtemps. Aujourd’hui vous m’avez grisé à me faire perdre la raison.
Alors, tout à coup, elle sembla en prendre son parti, se résigner à parler d’affaires et à renoncer aux plaisirs.
— Asseyons-nous sur ce rocher, dit-elle, nous pourrons causer tranquillement.
Ils grimpèrent sur le roc un peu haut, et lorsqu’ils y furent installés côte à côte, les pieds pendants, en plein soleil, elle reprit :
— Mon cher ami, vous n’êtes plus un enfant et je ne suis pas une jeune fille. Nous savons fort bien l’un et l’autre de quoi il s’agit, et nous pouvons peser toutes les conséquences de nos actes. Si vous vous décidez aujourd’hui à me déclarer votre amour, je suppose naturellement que vous désirez m’épouser.
Il ne s’attendait guère à cet exposé net de la situation, et il répondit niaisement :
— Mais oui.
— En avez-vous parlé à votre père et à votre mère ?
— Non, je voulais savoir si vous m’accepteriez.
Elle lui tendit sa main encore mouillée, et comme il y mettait la sienne avec élan :
— Moi, je veux bien, dit-elle. Je vous crois bon et loyal. Mais n’oubliez point que je ne voudrais pas déplaire à vos parents.
— Oh ! pensez-vous que ma mère n’a rien prévu et qu’elle vous aimerait comme elle vous aime si elle ne désirait pas un mariage entre nous ?
— C’est vrai, je suis un peu troublée.
Ils se turent. Et il s’étonnait, lui, au contraire, qu’elle fût si peu troublée, si raisonnable. Il s’attendait à des gentillesses galantes, à des refus qui disent oui, à toute une coquette comédie d’amour mêlée à la pêche, dans le clapotement de l’eau ! Et c’était fini, il se sentait lié, marié, en vingt paroles. Ils n’avaient plus rien à se dire puisqu’ils étaient d’accord et ils demeuraient maintenant un peu embarrassés tous deux de ce qui s’était passé, si vite, entre eux, un peu confus même, n’osant plus parler, n’osant plus pêcher, ne sachant que faire.
La lecture finie, tu poses la fameuse question : Alors ?
Quelle que soit la nature de la provocation, il faut, d’une façon ou d’une autre, que tu obtiennes des élèves qu’ils formulent leur surprise : qu’ils découvrent ce qu’il y avait d’inattendu dans ce texte. Ici par exemple, la dimension satirique, finement carnavalesque d’un texte qui raconte une demande en mariage expédiée en quelques phrases pendant qu’on ramasse des crevettes sur la plage. A partir de là, en général, les réponses arrivent.
Étonnamment, les premiers éléments qui sortent ont souvent quelque chose de très scolaire. Finalement tant mieux : ce sont les observations formelles qu’on finit toujours par livrer sur un texte : c’est un dialogue, les paragraphes sont courts, il y a deux personnages, etc. Ok, c’est bon. Tu envoies un·e élève faire le secrétariat au tableau, ça marche bien ça, ça motive toujours. Ton ou ta secrétaire distribue la parole et note au tableau toutes les remarques qui sortent, dans l’ordre dans lequel elles sortent. De fait, on se retrouve rapidement avec toute une série de notions à expliquer, le cours prend sa forme en même temps que la lecture.
Mais tu ne voudrais pas mettre la charrue avant les bœufs.
En même temps que ces remarques un peu attendues, arrivent parfois des remarques plus subjectives, telles que : c’est drôle, c’est romantique, puis à la longue de vrais jugements : il arrive par exemple que certain·es élèves soient choqué·es. On le note : choquant. »
Mathieu Billière
Pour commander l’ouvrage, en attendant que notre librairie refonctionne, ça se passe sur le site des éditions Libertalia Lever la main – Vers un atelier autogéré de littérature en classe de français, par Mathieu Billière.