Philippe Séro-Guillaume, Philippe Geneste, À bas la grammaire, Quiero, 2024, 152 p., 22 €.
La thèse des auteurs est à la fois simple et stimulante. La conscience linguistique des enfants – donc des élèves – se construit progressivement par l’expérience. Dès lors il paraît évident que le meilleur moyen de proposer un enseignement qui la nourrisse soit la démarche constructiviste.
Sauf que la tradition grammaticale scolaire va très exactement dans l’autre sens : l’étiquetage a priori transforme l’enseignement de la grammaire en pure répétition du même et dessine finalement une langue fictive, en ceci qu’elle est étrangère à l’expérience qu’en ont les enfants et les adolescents en dehors du cadre scolaire.
Quelques exemples proposés dans le livre sont saisissants. L’idée par exemple qu’on identifie un nom parce qu’il est précédé d’un déterminant engendre des erreurs manifestes, liées à des confusions nées d’homophonies entre des déterminants, des prépositions, des pronoms, comme par exemple dans l’énoncé Je viens le voir où un enfant peut sans ciller identifier voir comme un nom puisqu’il est précédé de le.
D’autre part, la démarche répandue qui consiste à aller « du simple au compliqué » fait largement question. Pour donner un exemple, le linguiste Alain Bentolilla a proposé d’entamer l’enseignement du verbe par les verbes d’actions, plus simples à définir, pour ensuite parler des verbes d’état. Cette proposition fait bondir nos auteurs, qui mettent en évidence qu’elle revient à enseigner le fonctionnement du système verbal en laissant de côté le mot le plus employé de la langue française, en l’occurrence le verbe être.
Les auteurs développent donc des propositions didactiques, au sens fort du terme : en distinguant bien ce qui doit être connu de l’enseignant et ce qui est proposé aux élèves. Ces pratiques montrent le souci d’enseigner la grammaire non comme un catéchisme mais comme une prise de conscience linguistique par l’élève locuteur à partir de ses propres énoncés. Plutôt que de s’illusionner sur une hypothétique échelle de complexité, elles permettent une montée en théorie qui reste solidement implantée dans la conscience des élèves. Mais voilà, la tradition grammaticale relève trop souvent d’une folie terminologique, au sens le plus fort du terme, comme par exemple lorsqu’on désigne sous le nom de passé composé une construction qui relève en fait du présent.
Les auteurs proposent donc, par ailleurs, d’élaborer cette conscience linguistique en travaillant la matière même des textes. L’exercice du caviardage, longuement décrit, consiste à réduire un texte sans en changer un mot, juste en raturant. On voit se dessiner l’expérimentation des mécanismes de regroupement et d’articulation qui font la phrase puis le texte, à l’inverse des préconisations les plus récentes en la matière, l’enjeu pour les élèves n’est pas d’acquérir des connaissances mais de savoir nommer ce qu’on sait déjà faire.


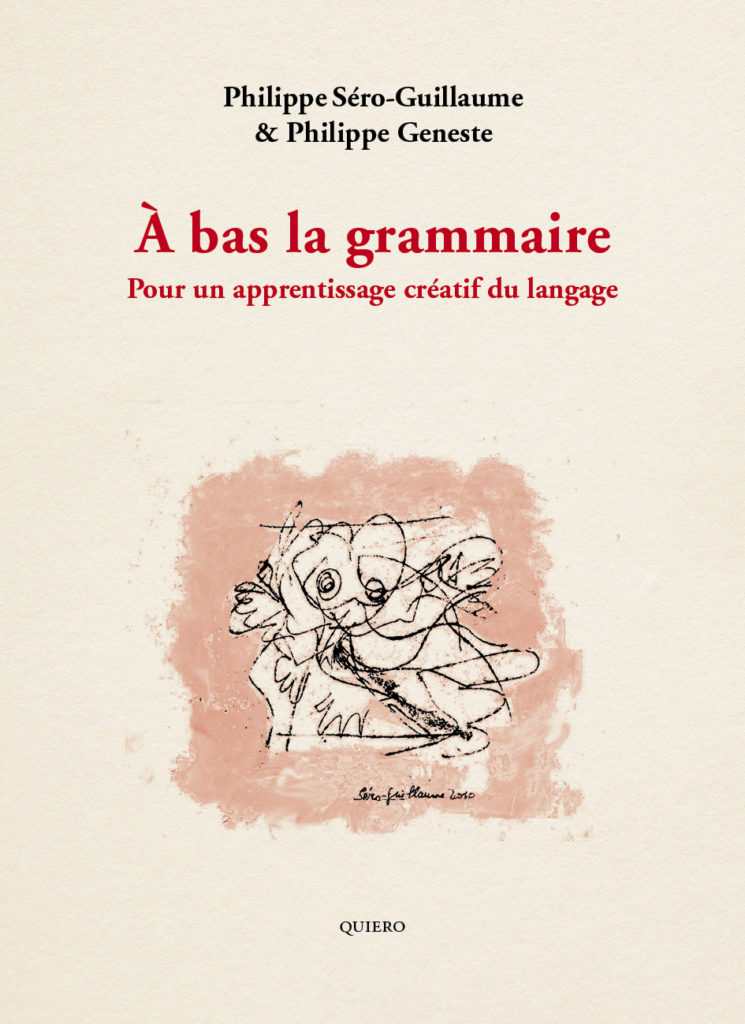
Contre Brighelli et autres adeptes du retour au BLED ! Merci à Mathieu Billière pour cette note de lecture sur le livre des deux Philippe. Pour aller sur le site de l’éditeur Quiero, on peut taper cette adresse : https://www.quiero.fr/spip.php?article344
Merci Mathieu.. Je m’empresse dele demander à mes nouveaux libraires de quartier. Bisous.