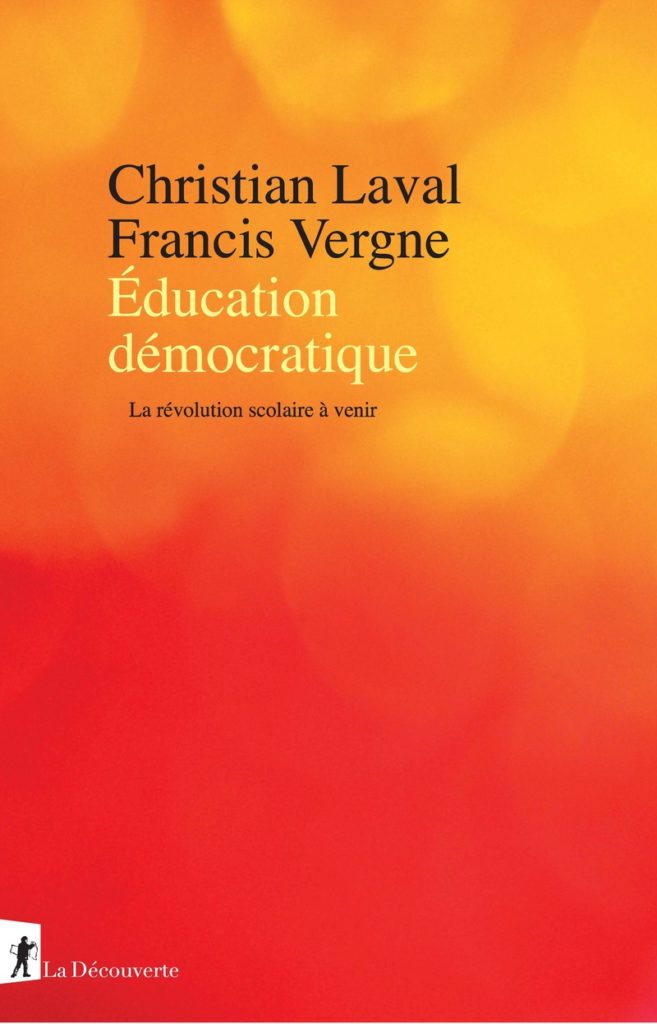Ce livre s’inscrit dans le travail de Christian Laval, qui mène une longue et patiente recherche sur la notion des communs et articule autour de celle-ci toute une série de réflexions comme en étoile, de la sorte émerge une véritable institution possible, une pensée qui tient debout.
Un intérêt majeur de cette pensée, c’est qu’elle est collective : Christian Laval ne signe que très peu d’ouvrages seul. Sa collaboration avec Francis Vergne, mais aussi avec Pierre Clément, Guy Dreux sur la question de l’école continue ici après Socialisme et éducation au XIXe siècle (Le Bord de l’eau 2018), L’École n’est pas une entreprise (La Découverte, 2004), La Nouvelle École capitaliste (La Découverte 2012) on voit se dessiner peu à peu une pensée cohérente sur l’école, si rare à l’heure actuelle.
Dans cette pensée en cours d’élaboration, ce livre semble constituer la première étape (avant d’autres ?) des «propositions offensives» (p.21), il développe de façon claire un projet de politique d’éducation dont le principe est le suivant : « l’éducation est un bien commun, pas une marchandise. ». En cela il s’inscrit dans le travail que fait Christian Laval depuis son livre fondateur sur les Communs, publié avec Pierre Dardot. Il s’agit ici, peut-on imaginer, d’une déclinaison de la notion pour l’éducation. Cette déclinaison se distribue en 5 principes : liberté de pense ; recherche de l’égalité dans l’accès à la culture et à la connaissance ; mise en œuvre d’une culture commune ; pédagogie instituante et enfin autogouvernement des institutions de savoir.
Ma problématique de lecteur est la suivante : si la plupart des principes paraissent tout à fait attirants, je ne cache pas mon inquiétude quant à cette notion de « culture commune » : si j’entends la nécessité d’en élaborer une, j’aimerais qu’il soit fait droit aussi à la nécessité d’y incorporer des pratiques culturelles populaires (et en disant ça, je ne pense pas nécessairement à l’accordéon musette). A ce titre, dans la présentation du troisième principe, il y a un postulat auquel je n’adhère pas complètement : « Pour les conservateurs, l’institution scolaire devrait essentiellement préparer à des carrières professionnelles et des positions sociales fortement différenciées. » (p.25). En fait, il me semble que les conservateurs travaillent aussi à faire de l’école un lieu de conservation d’une culture légitime qui est une culture des dominants, et que parmi les problèmes qui se posent quant à la démocratie éducative, celui-ci n’est pas des moindres. J’en veux pour preuve le vieux fantasme, revenu parmi nous, du programme national d’œuvres.
Le premier chapitre porte donc sur le premier principe : celui de la liberté de penser, avec une proposition offensive nommée « Université Démocratique ». Pour que le savoir reste un bien commun, il doit être éloigné, dans sa production comme dans sa diffusion, de tout intérêt particulier : on retrouve là la notion de laïcité par exemple, qui s’applique bien sûr aux religions mais aussi aux idéologies politiques, notamment à l’idéologie entrepreneuriale, de plus en plus offensive dans l’école publique. Pour cela, les auteurs proposent de mettre en place un système institutionnel qui ferait en gros de l’éducation un quatrième pouvoir dans le modèle libéral. On connait tous la proposition de Montesquieu sur la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire), il s’agit juste d’en rajouter un quatrième. A titre personnel j’ajoute qu’administrativement, il ne serait pas très compliqué de le faire, la forme scolaire est déjà bien séparée en soi dans la société scripturale-scolaire. L’Université Démocratique, au fonctionnement autonome, doit rassembler en son sein l’ensemble des enseignants et des chercheurs ainsi que toutes autres personnes pour peu qu’ilelles participent à la création et à la diffusion du savoir. L’important est dans l’idée d’autonomie : à cette institution de définir ses modalités de fonctionnement, de recrutement, etc. Elle permettrait aussi, selon le souhait des auteurs, la circulation des enseignants dans les différentes fonctions et niveaux. Enfin, elle participerait à une mise en place d’une sorte de république mondiale de l’éducation, permettant la circulation des connaissances, des pratiques, des personnes, à l’échelle universelle, avec un principe par exemple de redistribution du financement public par un système de péréquation.
Le troisième chapitre porte sur la question de la culture commune. En fait ils utilisent la bonne vieille technique de dire ce qui ne va pas et de suggérer en gros de faire à l’inverse, il s’agit donc surtout d’un chapitre de dénonciation. Voici à peu près les éléments dénoncés.
- L’école est enfermée entre deux conceptions des objectifs qui lui sont assignés. D’un côté une idée de l’école « efficace », visant à construire un capital humain et à préparer l’employabilité future des élèves, vision néo-libérale. De l’autre, et systématiquement opposée à celle-ci, la vision d’une école « humaniste », c’est à dire dispensant une culture générale entendue comme un savoir désintéressé, véritable appareil de distinction.
- La surenchère des contenus, outre qu’elle est la forme exacerbée de la pédagogie bancaire – selon le terme de Paolo Freire – est de fait un véritable outil d’aliénation des élèves et des enseignants, formulée dans sa substantifique moelle dans l’auto injonction à « finir le programme »
- La culture évaluationniste (le mot est de moi est un outil de contrôle permanent (ou continu, selon ce que les auteurs appellent joliment un lapsus administratif) qui engendre un enseignement entièrement tourné vers les exercices codifiés et fameuses « méthodes »
- La hiérarchisation, dont la forme la plus apparente se joue entre les disciplines. On peut énumérer quelques oppositions qui structurent l’enseignement français aujourd’hui : scientifique vs littéraire / technique vs général / pratique vs théorique / pur vs appliqué. Problème l’école n’y suffit pas su ce n’est pas accompagné d’un processus social plus général de déhiérarchisation des pratiques, métiers, représentations. C’est une vraie question politique.
Le projet vise donc d’abord à déhiérarchiser les savoirs, ce qui signifie mettre dans une sorte de vaste tronc commun des domaines différents : cultures humaniste, scientifique, technique, physique (ou sportive si l’on préfère). Par ailleurs cela implique d’éliminer toute forme de coefficient entre les disciplines.
Mais les auteurs soulignent que cette démarche n’est pas possible sans un travail sur les représentations sociales de ces différents domaines, l’ «égale dignité» des savoirs et des cultures est avant tout une question sociale.
Ensuite, les auteurs abordent la question de la pédagogie, qu’ils souhaitent instituante. « Ce qu’il nous faut mettre en valeur, écrivent-ils, c’est le lien entre la pratique de la démocratie dans la formation elle-même et celle requise par une société dont le fonctionnement procéderait de l’autogouvernement.» (p.142). Ce lien est posé dès la fin du XIXe siècle, en fait dans une chronologie qui correspond à peu près à celle de l’éducation nouvelle. Les auteurs partent de la réflexion de Durkheim, qui théorise l’idée qu’on éduque pour intégrer dans une société qui existe déjà. L’idée pourrait tout à fait convenir aux courants les plus autoritaristes. À ceci près que le sociologue, tout en validant ainsi l’autorité «naturelle» du maitre, commence à théoriser la société classe pour en faire l’espace d’initiation – au sens plein du terme – à la ritualité collective et démocratique. Il est cité p.150 : « Pour apprendre et aimer la vie collective, il faut la vivre, et pas seulement en idée et en imagination, mais en réalité.». C’est cette position que les auteurs de l’ouvrage proposent comme point de départ de l’histoire de l’éducation démocratique.
Par la suite vient une sorte d’inventaire des grandes propositions pédagogiques autour de l’idée de démocratie, en s’appuyant sur les figures de Dewey, Freinet, Freire, Fernand Oury jusqu’à arriver à l’idée clef selon laquelle la société classe sert non pas à remotiver la société déjà là mais bien à donner aux élèves les moyens de mettre en place leur société à eux à partir de ce dont ils héritent. C’est ainsi que l’école dépasse son statut de simple relais pour acquérir une fonction authentiquement instituante.
Ces considérations mènent logiquement au cinquième chapitre, qui défend « l’autogouvernement des institutions du savoir ». L’idée force est de faire de chaque établissement un commun éducatif, un « espace institutionnel autogouverné qui assure un accès universel aux savoirs » (pp.183-184). Trois modèles d’expérimentation du commun sont inventoriés.
D’abord Le modèle socialiste d’éducation du prolétariat, source de l’éducation dite intégrale, qui se veut un continuum de l’atelier à la salle de classe. En bons connaisseurs (on fait l’hypothèse que c’est Christian Laval qui a rédigé l’essentiel de ces lignes, même si cela importe peu), les auteurs reviennent sur la proposition de Marx d’une éducation financée et contrôlée par l’état mais qui ne soit pas sous le contrôle du gouvernement, on pourrait parler, nous semble-t-il, d’indépendance de l’éducation comme on parle d’indépendance de la justice par exemple.
Ensuite vient le modèle qu’on pourrait appeler le courant Condorcet, d’où provient la conception républicaine de l’école. Pas de malentendu, l’usage galvaudé et outrancier du mot républicain à l’heure actuelle ne doit pas nous aveugler : l’école républicaine du courant Condorcet, c’est celle qui place au centre la formation du citoyen. Cette école là en appelle à l’autonomie des savants qui éduquent le peuple. Mais il s’agit d’un modèle inabouti, qui ne résout pas le problème intrinsèque de la société classe : comment accorder de véritables droits politiques à des élèves considérés comme juridiquement mineurs ? (p.190)
Enfin le troisième modèle est celui de l’éducation nouvelle elle-même, centrée sur l’autonomie pédagogique des élèves, telle qu’elle a été initialement théorisée dans le livre d’Adolphe Ferrière, L’Autonomie des écoliers, paru en 1921, l’année même du premier congrès de l’éducation nouvelle.
En conclusion de ce chapitre on retiendra deux propositions pour relancer la réflexion sur une éducation démocratique : la recherche d’un fondement démocratique de l’autorité du maitre, qui passe sans doute par la nécessité du principe d’autonomie comme cœur de l’institution éducative. D’où un nouvel inventaire, celui des expérimentations d’écoles autonomes. Celles héritières du mouvement de mai 68 ont souffert du rejet de toute forme institutionnelle, les expériences, pour intéressantes qu’elles aient été, n’ont pas été pérennisées ; mais l’autogestion institutionnelle s’installe malgré tout en France, trop tardivement pour essaimer selon les auteurs, d’où le faible pouvoir d’entrainement des lycées autogérés par exemple.
D’autre part, des expériences internationales, comme le réseau des écoles indépendantes en Espagne à partir de 36, inspirées largement des propositions de Ferrer, ou encore l’école populaire Kanak, l’éducation zapatiste, autant d’expériences racontées dans le livre de Grégory Chambat L’École des barricades, mais dont les auteurs pointent une limite : elles sont liées intrinsèquement à des moments de « crise ». Là encore, la traduction institutionnelle, condition de la pérennisation selon eux, est insuffisante.
A partir de là, les auteurs esquissent des pistes programmatiques : ils proposent de structurer chaque établissement en trois assemblées collégiales : celle des élèves, celle des parents, celle des enseignants. Ces trois assemblées envoient des délégués à un Conseil d’Établissement, instance de direction, présidé par un enseignant élu en son sein et assisté d’un vice président. Les auteurs tiennent à ce que la présence aux assemblées est un caractère obligatoire, façon selon eux de lutter contre une sorte de délégation outrancière qui consiste à se laver les mains de l’action une fois qu’on a voté par exemple. Les mandats seraient en nombre restreints, les enseignants élus non déchargés de cour, l’enjeu est ici d’empêcher une forme de «professionnalisation» de cadres. Les mandats sont également révocables.
Les auteurs proposent, pour donner une cohérence à l’ensemble du système éducatif, d’organiser les établissements sous une forme fédérale de sorte que « le responsable élu [ne soit] plus le représentant de l’état dans la communauté et à ce titre son chef, [qu’il soit] le représentant de la communauté scolaire auprès de l’état central. »
Pour maintenir ceci dit l’égalité territoriale, ce dispositif doit se mettre en place dans le cadre d’une fédération des communes qui propose une définition générale de la politique éducative, le cadre juridique et les financements. On voit ici l’ouvrage s’inscrire dans le cadre des réflexions plus larges d’organisation sociale proposées notamment par Christian Laval.
Enfin, garantie de l’indépendance académique, la fédération des établissements s’organiserait également en articulation avec ce que les auteurs nomment l’université démocratique, chargée de définir le contenu et dont la définition ouvrait l’ouvrage.
Les propositions des auteurs, ancrées sur des analyses solides, sont tout à fait séduisantes. Tout pédagogue soucieux de faire de ses élèves des acteurs de leur propre vie démocratique devrait avoir l’impression d’un grand bol d’air à la lecture de ce livre.
Pourtant il reste quelque chose de vaguement indéfini du côté des fameux « contenus » et de leur articulation avec les questions pédagogiques d’un côté et institutionnelles de l’autre. Il semble bien, même s’ils sont conscients que la question se pose, que les auteurs ne parviennent pas vraiment à remettre en cause ce qui constitue aujourd’hui le socle des savoirs canoniques à « transmettre » selon l’expression consacrée. Le chapitre III sur la notion de « culture commune » apparait dès lors comme présentant le plus de matière à discussion : certes l’exigence de mettre au programme les cultures non légitimées, populaires, locales, etc. est soulignée, mais il semble bien que la remise en cause des cultures légitimées ne soit pas envisagées en profondeur comme une possibilité pédagogique.
Le professeur de lettres que je suis a ainsi lu avec beaucoup d’intérêt le développement intitulé « Littérature et démocratie » et y a rencontré cette formule : « Ce fut une grande erreur d’une partie du mouvement ouvrier de dénoncer cette culture classique comme “aristocratique” ou “bourgeoise”. Jaurès est l’un de ceux qui auront le plus fait pour combattre tout ce qui pouvait ressembler à un nihilisme faussement prolétarien ou à un utilitarisme démagogique.» (p.119). Que dans une démarche d’émancipation des élèves – de milieu ouvrier ou autre d’ailleurs – il soit contre-productif, voire dangereux, d’écarter la culture dominante, on en convient volontiers. Mais par la suite, le rapprochement qui est fait entre la littérature et le droit de tout dire nous parait un peu rapide et, pour tout dire, trop proche du caractère presque religieux que revêt l’enseignement des chefs d’œuvres tel qu’il est mis en place aujourd’hui notamment dans les nouveaux programmes du lycée.
Sans même étendre trop loin le corpus, jusqu’à la twittérature, etc. (mais après tout, pourquoi pas ?), il nous semble qu’un enseignement démocratique des lettres passe bien plus par un récit des tensions qui traverse cette univers que par une série d’exercices d’admiration. La question de l’écriture comme droit de tout dire, par exemple, n’a en fait rien d’évidente, pour faire vite, on connait les considérations de Borges sur la censure comme terreau fertile du littéraire ; dans un sens différent, les travaux de l’OuLiPo montrent à l’envi combien l’autocontrainte est productive ; même la poésie du cri, la plus libre qui soit formellement, obéit à une rhétorique formalisable (laquelle d’ailleurs ne l’épuise pas).
Autre point, sur la question pédagogique, il manque, comme trop souvent, la description du travail au sein de la société classe, du fonctionnement fin de la relation pédagogique. On le regrette, car sans doute là, dans des échanges immédiats, des imprévus – selon le beau mot de notre ami Arthur Serret – se glisse la matière démocratique même : quel accueil fait-on à ce qui s’immisce dans l’instant. Freinet, Freire chacun à leur façon, avaient tenté de donner un cadre à cette nécessité, pour la société classe, de réagir à ce qui émerge.
Nous sommes durs, deux notions sont bien présentes dans l’ouvrage : celle d’imagination pédagogique et celle de désir de savoir, et sans doute constituent-elle, imbriquées avec les questions institutionnelles, un programme de recherche prometteur et déjà entamé du reste. Quand bien même, vu la violence de l’offensive réactionnaire que nous subissons à l’école, et la violence décuplée de celle qui semble s’annoncer, vue l’urgence corollaire de construire notre résistance et un contre-projet, a-t-on bien les moyens de faire la fine bouche ? Éducation démocratique reste à nos yeux un ouvrage essentiel dans le temps présent et sans doute à terme.
Par Mathieu Billière