96% de réussite au bac : un acte de résistance
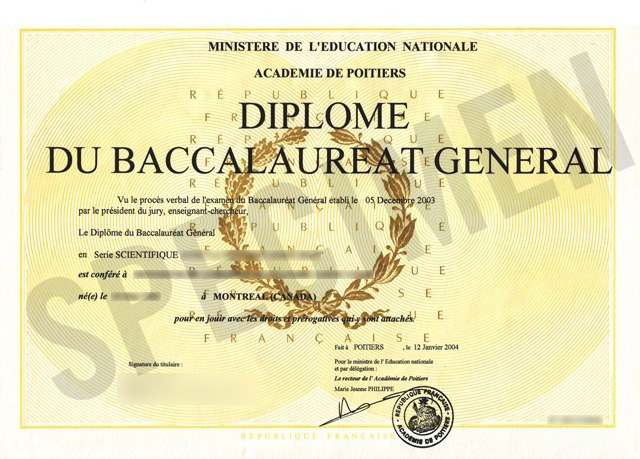
On nous bassine à nouveau depuis quelques temps avec l’évaluation au bac, le niveau baisse-ça ne peut plus durer-de mon temps et patati et patata. Ce ne serait rien si ce n’était que la Nième offensive réactionnaire, mais cette fois l’obsession a commencé à contaminer des cercles plus réfléchis, au point que la ministre s’est sentie obligée de réagir, nous rappelant par là-même son existence.
Aussi, vu depuis un professeur de lettres au lycée (et par conséquent aussi un examinateur), quelques rappels semblent nécessaires. On y va.
Il n’y a pas de niveau étalon, le “niveau” d’un élève est la mesure de la correspondance du travail qu’il a fourni avec une norme scolaire admise, au regard d’un élève fictif qu’on pourrait qualifier de “bon fils de famille” si la notion de “bon père de famille” n’avait pas enfin disparu du droit en 2014. Il serait assez aisé de reconstituer cet idéal-type en croisant les programmes d’enseignement, les compétences du livret scolaire et les critères d’évaluation proposés chaque année aux correcteur·ices. L’enjeu est donc très évidemment celui-là : de quels élèves veut-on ? Et comment allons-nous rédiger les différents documents à partir de cette représentation qui est la nôtre ?
Actuellement, en lettres, le bachelier idéal-typique sait réciter des interprétations vues en classe, connaît les normes des différents exercices, y compris en termes chiffrés (nombre de pages, de lignes, de mots, minutage des oraux…). Ces normes passent par quelques implicites qui font l’objet d’enseignements en classe. Il est d’usage par exemple que la dissertation soit en trois parties, malgré les appels régulier à ne pas trop se fier à cette norme quand on corrige. Partant de là, l’exercice devient paradoxalement plus facile. Pour peu que l’enseignant·e ait pris soin de bien expliquer ces normes, de donner les éléments essentiels attendus à propos des œuvres au programme et des parcours, de fournir des explications solides pour l’oral, pour peu que, de son côté, l’élève ait pris le temps de faire les exercices demandés et de réviser ce qui a été dit en cours, l’épreuve sera réussie. Les bons résultats au bac, si on part de là, s’expliquent de façon très simple : bon an mal an, les élèves font le boulot qu’on leur demande de faire. Il n’est pas interdit de s’en réjouir.
Outre l’engagement des élèves dans leur scolarité, ces résultats démontrent aussi que les enseignant·es savent faire : iels répondent à la commande publique en explicitant les normes attendues et en donnant aux élèves les moyens d’y répondre. On devine l’essentiel : tout se joue du côté de ces fameuses normes. Il s’agit bien d’une question politique. Autrement dit, il s’agit de savoir ce que nous attendons de notre école, le bac étant en quelque sorte le quitus de sortie de 15 années d’enseignement scolaire.
Là encore, le monde éducatif sait faire, il suffit de le lui demander. Veut-on une école sélective ? Du tri social ? Facile : on propose une dissertation de littérature générale, on exige que celle-ci soit conforme au plan en 27 points (3 parties de 3 sous-parties de 3 points), avec un exemple d’œuvre « issue de vos connaissances personnelles » pour chaque point. Emballez c’est pesé, on vérifie les habitus de classe.
Veut-on une école émancipatrice, qui donne à chacun non pas une chance mais une place, on construit un bac en format de recherche : mémoire préparé tout au long de l’année et soutenu en juin, sous la direction d’un ou plusieurs enseignant·es, avec possibilité de travail interdisciplinaire, mesure de la progression et du travail fourni qui entre dans l’évaluation certificative, critères explicites d’évaluation, etc.
Entre ces deux pôles, toute une série de possibilités, il n’y a plus qu’à demander clairement à la société, soit directement soit en passant par les institutions démocratiques, quelle école elle souhaite pour ses enfants. On saura alors clairement s’il faut ou non traduire « le niveau baisse » par « on donne le bac à n’importe qui » (comprenez les classes sociales défavorisées).
Il y a de ça quelques années, le personnel politique en campagne électorale utilisait le mot logiciel pour désigner le corpus d’idées fondatrices de leurs propositions. Reprenons-le. Le logiciel du pouvoir actuel s’articule de façon limpide autour du couple performance/élimination. A ce titre, un taux de 96 % de réussite au bac est, pour ce pouvoir, une épine dans le pied. Nous pourrions, nous autres personnels éducatifs, le prendre à notre compte comme un acte de résistance à ce logiciel mortifère.
Mathieu Billière
