Est-ce qu’on travaille encore à l’école ?
Lire l’introduction de notre série d’articles
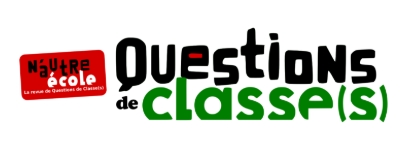
1- Est-ce qu’on travaille encore à l’école ?
« On sait bien que le meilleur contrôle social est celui qui a été précocement intériorisé. Le bon élève, n’est-ce pas celui qui se dit tout seul : ai-je choisi le bon exercice ? adopté la bonne méthode ? pris mes affaires ? fait correctement mes devoirs ? Il se contrôle constamment lui-même, relayant sans s’en rendre compte ses maîtres et ses parents. L’apprentissage du métier d’élève fait l’objet d’une socialisation intensive, d’une éducation morale, d’un effort soutenu, dans les premiers degrés de scolarité, pour que l’enfant intériorise les normes et les formes du travail scolaire. Il y a des métiers qu’on peut exercer avec un certain détachement, sans s’y impliquer complètement, en considérant qu’on n’est pas marié avec son » job « . Vivre le métier d’élève avec autant de détachement est beaucoup plus difficile, parce que le monde des adultes, tant du côté de la famille que de l’école, dit d’une voix unanime : » Travaille comme il faut, tu es en train de jouer ta vie, ton bonheur, ta réussite sociale, ta vie » ».
Philippe Perrenoud, Métier d’élève : comment ne pas glisser de l’analyse à la prescription ?
Nous sommes en juin, dans un collège. Les professeur·es organisent la fin de l’année, notamment la semaine de révision du brevet pour les 3e : faut-il prévoir une ou deux heures par matière ? Des entraînements sur table ou des révisions ? Et à la maison, quels devoirs leur donner à faire ?
Et au final, les mêmes plaintes qui reviennent sur le manque de travail des élèves, leur nonchalance face à l’échéance qui approche, ou le vide de leurs copies. Et plus tard, l’indignation face aux consignes de correction demandant, selon ces mêmes collègues, de « tout accepter » de façon à ce que toustes aient le brevet sans effort.
***
Travailler à l’école : jouer ou souffrir ?
– « Les élèves ne travaillent plus et ne savent plus travailler ; ils n’ont aucun sens de l’effort ; ils sont fainéants ; maintenant, il faut être bienveillant ; on fait de la garderie ; on ne peut même plus faire de vraie leçon ; le niveau est catastrophique ; il faut plus rien leur demander ; ils ne veulent plus rien faire ; ils s’en fichent des notes ».
– « L’école n’apprend plus rien aux jeunes ; les profs sont laxistes et ne savent plus se faire respecter ; les jeunes arrivent en entreprise sans savoir écrire deux lignes correctement ; nous, à leur âge… »
Qu’il soit tenu par des personnels de l’éducation, des familles ou certains médias, il s’agit là du même discours, toujours accusateur vis-à-vis de l’école ou des élèves. Le travail est souvent perçu à travers une opposition binaire, réductrice et sans nuance dans laquelle les concerné·es, personnels comme élèves, ne se reconnaissent pourtant pas.
Il y aurait ainsi d’un côté l’école du laxisme et de l’enfant-roi-au-centre-et-tout-puissant, laquelle ne demanderait plus rien aux élèves et les surévaluerait de manière démagogique afin que tou·tes aient le bac sans le mériter. L’école serait alors le lieu du ludique et de la garderie, de l’anarchie, iront jusqu’à dire certain·es : à l’école, on joue et on ne travaille plus, dans la nonchalance et l’irrespect.
De l’autre côté, il y aurait l’école sérieuse et austère, la Vraie, celle du cours magistral et des classes autobus* ; l’école de l’exigence et de la soumission, qui cultive l’excellence et la sélection, le sens de l’effort et l’abnégation : à l’école, on apprend et on travaille, dans la souffrance et le sacrifice.
Le rôle des familles est également régulièrement critiqué : « cette mère ne vient pas au rendez-vous, ne répond plus au téléphone ; c’est aux parents d’éduquer leurs enfants, pas à nous ; ils ne font pas leur travail ». La question des devoirs à la maison devient ainsi l’occasion d’une remise en cause de l’éducation parentale, et non celle d’un apprentissage et d’un accompagnement, encore moins d’une co-éducation.
C’est comme si tout, dans la vie des jeunes, devait être organisé autour du travail scolaire et soumis aux exigenceset au rythme de l’école : il faut y consacrer plusieurs heures le soir même si les parents rentrent tard du travail ; s’inscrire aux séances de Devoirs faits,faire passer ses loisirs après les devoirs, voire y renoncer quand on est en difficulté.
Sont ainsi valorisé·es, en plus des élèves qui bénéficient d’un bagage social, scolaire et/ou culturel plus riche, celles et ceux qui ont le mérite de se donner corps et âme à leur travail, de se fatiguer pour correspondre aux normes scolaires, que cela se solde ou non par des résultats d’ailleurs : l’essentiel est de se dévouer à son travail. Pour beaucoup, il faut du sérieux, de la contrainte, des efforts soutenus et de la souffrance sinon ce n’est pas du travail.
Le travail, un outil de tri et de contrôle
Le parallèle est frappant avec le monde capitaliste de salariat : une cadence unique dont il ne faut pas sortir, une standardisation des tâches ; un isolement et une surveillance accrue des individus par des évaluations incessantes ; la culpabilisation et l’exclusion de celles et ceux qui ne savent pas faire au lieu de consacrer du temps et des moyens à leur formation.
De plus en plus en effet, l’on remarque une perméabilité de l’école à l’entreprise : stages de découverte ou de pratique professionnelle à différentes étapes de la scolarisation ; invitation de patron·nes pour intervenir auprès des élèves ; partenariat école-entreprise, etc. Le tout avec la volonté de mettre en avant le modèle de la réussite par le travail et le sacrifice, d’éblouir avec des parcours individuels exceptionnels, présentés hypocritement comme des destins à la portée de chacun·e… à condition de se soumettre et d’obéir aux exigences de l’école et de l’entreprise, cette dernière ayant elle-même intégré les normes scolaires du « contrôle continu » et des entretiens d’évaluation.
Créer, faire preuve d’originalité ou de personnalité ? Cette libération des contraintes n’est observable et valorisée que chez l’élite des travailleurs·euses, comme des élèves. Car être scolaire et conforme aux consignes ne suffit même pas : il faut exceller, savoir dépasser les attentes scolaires, apporter une culture supplémentaire, que l’institution scolaire se garde bien de transmettre.
À l’école ou dans l’entreprise, le travail sert ainsi à sélectionner et trier celles et ceux qui réussissent et les individus qu’il faut pousser… ou traîner, jusqu’à les reléguer dans les marges ! Car, si les exclu·es du monde du travail existent – précaires, chômeuses·eurs, sans-papièr·es exploité·es –, ils et elles existent également à l’école.
Il est en effet de trop nombreuses manières d’écarter un·e jeune du parcours scolaire ordinaire et des apprentissages essentiels et communs à sa génération : multiplication des exclusions ; externalisation des élèves en difficulté dans des dispositifs éloignés parcours commun (Ulis, Segpa, IME, par exemple) ; relégation au fond de la salle ; ou encore scolarisation différenciée dès le plus jeune âge. La division du travail dans l’entreprise trouve ainsi son écho dans les classes, dans les pratiques pédagogiques où l’on peut voir les méthodes actives réservées aux bon·nes élèves, prétendument plus capables de complexité, avec pour les autres, dont les capacités seraient d’emblée limitées, les méthodes répétitives et mécaniques du B.A.-ba.
Voilà une vision bien aliénante et utilitariste du travail qui n’est que hiérarchisation, mise au pas et séparation des êtres, des tâches et des savoirs entre les différents niveaux de décision, de conception et d’exécution.
Cette hiérarchisation, à la fois héritée du monde de l’entreprise et construite par l’institution scolaire elle-même, constitue en effet l’un des freins les plus importants à la construction d’une école du commun, égalitaire et inclusive. Il y a ainsi, à la fin de ce collège plus ou moins « unique », une structuration des parcours entre la voie générale – valorisée – et la voie professionnelle – considérée comme un échec et comportant même des formations dites réservées aux élèves de Segpa, d’Ulis ou d’UPE2A –, avec une spécialisation des enseignements selon qu’on apprend un métier ou que l’on se destine à des études longues. Aux un·es, les savoirs et compétences des différents corps de métier, les découvertes professionnelles, aux autres les sciences et la culture générale, avec de moins en moins de passerelles entre les deux voies, comme si tout était définitivement décidé à 15 ans – voire à 3 ans selon la ministre Elisabeth Borne – , avec tout ce que cela comporte de pression et de culpabilisation pour les jeunes, leur famille et les équipes éducatives aux différents seuils d’orientation : être sûr·es, ne pas se tromper, accompagner la construction de l’orientation, etc. L’école forme de futur·es travailleurs et travailleuses, parfois précocement spécialisé·es et toujours soumis·es aux diktats de l’entreprise.
Au final, très tôt, les jeunes ne bénéficient pas de la même formation. Sous prétexte d’adaptabilité ou au monde du travail, ou au profil des élèves, les parcours sont différenciés et tou·tes n’acquièrent pas les mêmes outils pour comprendre le monde et encore moins pour y agir. L’école d’aujourd’hui, sciemment, reproduit et légitime les divisions et les inégalités sociales. Dans ce contexte, répéter qu’il faudrait revaloriser les filières professionnelles sans contester l’organisation générale de la société paraît n’être qu’un vœu pieux.
Pour une école polytechnique et une éducation intégrale
À l’inverse de cette école du tri, de la séparation et de la normalisation, où jeunes comme adultes sont dépossédé·es de leur travail et se le voient imposer, il est possible d’opposer une vision égalitaire, émancipatrice, active et créative de l’enseignement et des apprentissages, inspirée de l’éducation populaire et du mouvement ouvrier.
Ici, plus question de hiérarchie, ni entre les disciplines ni entre les formations, encore moins entre les individus : l’éducation du corps importerait autant que celle du cœur et de l’esprit. Les disciplines scientifiques, industrielles, artistiques, sportives, etc. auraient la même importance, sans distinction entre le manuel et l’intellectuel – opposition qui nourrit les divisions de classes, l’organisation capitaliste de la société et l’exploitation des plus fragilisé·es. Des disciplines comme le droit, les sciences politiques ou la sociologie seraient introduites dans les parcours communs, et non plus réservées à une élite. Car l’éducation intégrale, ou polytechnique, entend permettre aux jeunes de bénéficier d’un enseignement généraliste jusqu’au lycée, afin qu’elles et ils choisissent et construisent leur parcours de manière lucide, consciente et volontaire. Dans cette école du peuple, avec et pour le peuple, il s’agirait d’offrir une formation plus complète à chacun·e, avec tous les outils nécessaires pour comprendre et analyser le monde, mais aussi y agir et le transformer comme le permettent par exemple les pratiques de la pédagogie critique luttant contre les rapports de domination à l’école comme dans la société.
Le travail devient ici ce par quoi chacun·e pourrait s’épanouir et trouver sa place dans la société, sa place parmi les autres et pour les autres, et non ce travail aliénant auquel il ne s’agit que de se soumettre pour le bénéfice de patron·nes ou d’actionnaires.
Mais alors, concrètement ?
Contre une école et une société qui acteraient des déterminismes socioculturels et enfermeraient élèves et adultes dans le fatalisme et le découragement, ou dans la recherche d’une réussite strictement individuelle, il s’agit de considérer avec les pédagogues de l’Éducation nouvelle que tou·tes les jeunes sont capables. Capables d’apprendre, de penser et d’agir. Capables de grandir, d’évoluer et de s’émanciper. Cela modifie assurément notre regard et l’accompagnement que nous construisons au quotidien.
Dans cette école polytechnique, les pratiques coopératives sont privilégiées, afin de favoriser le travail collectif, l’entraide et les échanges de savoirs avec, par exemple, la création de journaux ou de documentaires comme les BT*, ou encore la mise en place de classeurs de recherches libres, où les jeunes mettent à disposition de tou·tes le fruit de leur travail personnel. Plus de tri entre dominant·es et dominé·es, de classement entre bon·nes et mauvais·es élèves, mais des jeunes qui apprennent, évoluent, progressent en bénéficiant de conseils et de parcours qui ne nient pas leurs difficultés spécifiques, qu’elles soient scolaires, culturelles ou sociales mais qui y recherchent, collectivement, des solutions. Entretiens d’explicitation pour comprendre et affiner les démarches de travail, journal des apprentissages pour partager les réussites et les difficultés, compagnonnage pour affiner les connaissances et les pratiques. Le travail coopératif tient compte de l’impossibilité, pour les jeunes comme pour les adultes, de tout savoir, de tout maîtriser seul·es : chacun·e a besoin du regard de l’autre, de son aide et de ses conseils. De plus, le fait d’accompagner d’autres personnes construit et développe un sentiment de confiance et de puissance d’agir indispensable pour s’engager authentiquement dans les apprentissages et les échanges.
Contre la panique des programmes à boucler, qui empêche les personnels et les élèves d’avoir la main sur les rythmes de travail, nous proposons de prendre collectivement le temps de penser les apprentissages et les enseignements, de penser notre travail pour nous libérer de l’aliénation de l’urgence.
Pour un travail choisi et émancipé
Ici, le travail, source de découvertes, devient également l’occasion de mettre en œuvre sa créativité, de développer sa personnalité et son autonomie. Dans les pratiques inspirées de la pédagogie Freinet, par exemple, définie comme une « pédagogie du travail », les élèves deviennent non seulement acteurs et actrices, mais aussi auteurs et autrices : au lieu de se voir imposer une cadence, une succession de tâches dont le sens n’est pas perceptible, et, plus tard, une orientation, elles et ils choisissent librement et volontairement, individuellement et/ou collectivement, leurs sujets d’investigation ou leurs travaux de groupes, tâtonnent dans leurs apprentissages, organisent le travail lors des Conseils d’élèves, toujours accompagné·es par les enseignant·es et par leurs pair·es. Leur Plan de travail, négocié et construit avec les adultes dans le cadre des programmes communs mais sans s’y limiter, illustre un parcours d’apprentissage exigeant et cohérent, porteur de sens et de vie, ponctué par des temps forts où ils et elles partagent le fruit de leur cheminement avec le groupe, car il ne s’agit pas de s’enfermer dans un travail individuel et isolé des autres. Librement choisies, les tâches prennent du sens et sont investies par les jeunes qui, dès lors, ne sont plus enfermé·es dans la passivité d’un travail imposé.
« On a souvent cru, explique Nicolas Go, (et, il est vrai, parfois, dans certaines classes, remarqué) que les élèves en pédagogie Freinet sont livrés à eux-mêmes, dans une débauche d’activité sans exigence. C’est pourtant tout le contraire : ce qui frappe les visiteurs, observant les élèves en action, c’est l’organisation complexe du travail […] ceci exige une grande expertise [de l’enseignant·e], à égale distance entre le dirigisme (qui consiste à tout programmer) et le laxisme (qui consiste à ne rien exiger). Ce qu’il vise, c’est l’appropriation par les élèves, non seulement de l’activité de pensée et d’élaboration des savoirs, mais également de la pratique sociale, inscrite dans un complexe d’institutions et d’habitus. »
La mission des pédagogues consiste alors à accompagner les jeunes dans ce cheminement vers l’autonomie, la prise de décision et la responsabilité à la fois individuelle et collective, où chacun·e développe le sentiment de pouvoir agir sur son parcours scolaire en se reconnaissant dans le travail effectué. Yves Clot, à propos de la souffrance au travail, souligne en effet la nécessité, pour les travailleur·euses, de se reconnaître dans ce qu’elles/ils font et de participer à quelque chose de sensé, de défendable à leurs yeux. Le parallèle est frappant avec les élèves que l’on dit décrocheurs·euses et qui souffrent, comme le souligne Serge Boimare, d’une peur d’apprendre et d’un manque de compréhension et de reconnaissance dans le travail scolaire.
Si le travail est une question centrale à l’école, celle-ci dépasse la simple opposition entre amusement et austérité, entre laxisme et exigence. Elle ne se limite pas non plus à la seule mise au travail des élèves, avec leurs difficultés et leurs facilités.
La question du travail à l’école rejoint celle des finalités de l’éducation : à qui s’adresse l’école ? Quelle vision du travail, des travailleuses et des travailleurs, de la société et du monde véhicule-t-elle ? Quelle formation, pour quels futurs individus ?
Avec l’école polytechnique et coopérative, nous faisons le choix d’une école qui s’adresse également à tou·tes les jeunes et qui forme des êtres éclairé·es, créatifs·ives et émancipé·es, capables de s’organiser, de décider et d’agir à l’école, sur leur lieu de travail comme dans la société.
Grégory Chambat, Jacqueline Triguel
Pour aller plus loin :
Boimare Serge, L’Enfant et la peur d’apprendre, Dunod, 2014.
Une manière différente d’envisager les empêchements à apprendre des jeunes, avec la nécessité de prendre d’autres chemins pour les aider à surmonter ces « déstabilisations identitaires » que sont les temps d’apprentissage.
Clot Yves, Le Travail à cœur, La Découverte, 2010.
Prenant pour points de départ la souffrance au travail, les Risques psycho-sociaux et leurs origines organisationnelles, Yves Clot s’interroge sur ce qui permet de soigner la santé au travail, en particulier dans les collectifs de travail et dans une conflictualité réinstaurée sur le sens des actes professionnels et sur les conditions du travail bien fait.
Willis Paul, L’École des ouvriers. Comment les enfants d’ouvriers obtiennent des boulots d’ouvriers, Agone, 2011.
Dans les années soixante-dix, le sociologue britannique Paul Willis observe, décrit et tente d’analyser les rapports de jeunes garçons issus de la classe ouvrière avec l’école. Leur rejet de l’institution, les résistances qu’ils mettent en œuvre, sont calqués sur les comportements de leurs pères à l’usine. Mais derrière cette révolte se déploient en réalité les mécanismes de reproduction de classe, au plus grand profit du système.
Fiction
Tetsuko Kuroyanagi, Totto Chan, la petite fille à la fenêtre, Pocket, 2008.
Une autobiographie qui rapporte la manière dont une enfant « différente » est rejetée par un système « traditionnel » et découvre la joie d’apprendre auprès d’un maître plus attentif à son rythme d’apprentissage qu’aux normes scolaires. Si l’expérience se déroule dans une école privée, elle nous paraît importante pour questionner le fonctionnement de l’école publique actuelle dans ce qu’elle a de sclérosant pour les apprentissages des jeunes.
Sur le Web
Vidéos : qu’as-tu appris à l’école ? – Site Questions de classe(s)
L’Aped (Appel pour une école démocratique), mouvement implanté en Belgique, a demandé à des jeunes tout juste sorti·es du système éducatif, ce qu’ils et elles avait appris et ce qu’ils et elles n’avaient pas appris à l’école. Un regard lucide sur les non-dits et les impasses du système éducatif.
*Les tables de la salle sont placées deux par deux, les unes derrière les autres.
*BT : Bibliothèque de Travail de l’Icem (Institut coopératif de l’École Moderne – Pédagogie Freinet)
