Enfance et lectures féministes #1 – Patricia Hill Collins
Les milieux « pédagogiques » en France sont souvent issus de l’éducation nouvelle. Les grands mouvements pédagogiques ont mis au centre de leur réflexion ce que les sociologues ont appelé la « forme scolaire », et ont souvent tenu leur critique de cette forme « scolaire » comme enjeu de politisation de l’éducation. Plus récemment, les pédagogies critiques qui se définissent par des pédagogies dont la finalité est la conscientisation et la transformation des rapports sociaux ont émergé en France. Le dictionnaire que nous préparons avec Questions de classe(s) et beaucoup d’autres camarades tend à rendre compte des expérimentations et réflexions des pédagogues sur le sujet. Émerge donc un enjeu aujourd’hui d’hybridation de traditions pédagogiques différentes, qui pousse à interroger les visions de l’enfance sous-jacente à ces pédagogies. L’enfance est par ailleurs problématisée à nouveau frais par les luttes dites « enfantistes »1, c’est-à-dire visant à la critique voire à l’abolition de la domination des adultes sur les enfants. Afin de réfléchir la question de l’enfance et de l’éducation, je proposerai donc une série de relectures de textes, notamment issus du féminisme marxiste et/ou intersectionnelle sur la question de l’enfance et de l’éducation. Si le féminisme est le courant politique qui a le plus parlé des enfants, la question de la « domination adulte » reste souvent un angle mort. Il s’agira de lire ces textes avec cette interrogation, d’aller lire la domination là où elle ne se dit pas comme telle. Cette entreprise comporte probablement beaucoup de maladresse. Disons le d’emblée, il ne s’agit pas de dénoncer à quel point les militantes opprimaient leurs mômes, mais de chercher dans leurs textes des manières de comprendre et complexifier la compréhension de la domination adulte, d’y chercher des outils pour contextualiser cette domination dans sa « consubstantialité » avec d’autres rapports de domination. Comme l’écrivent Elsa Galerand et Danièle Kergoat, il s’agit de considérer les systèmes d’oppression comme des « rapports sociaux qui sont des rapports de force vivants et fondamentalement dynamiques. Ce qui signifie qu’ils se rejouent et se recomposent en permanence au fil des pratiques sociales et qu’ils sont donc nécessairement variables dans l’espace et dans le temps »2. Cette série de textes pourrait être considérée comme un carnet de recherche sur le sujet.
Patricia Hill Collins, La pensée féministe noire
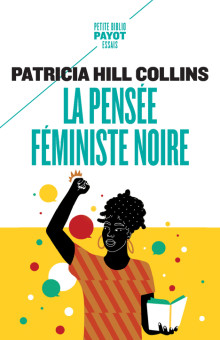
Patricia Hill Collins est une sociologue américaine. En 1990, elle publie un ouvrage important Black feminist thought, traduit en français par La pensée féministe noire. À la fois, texte sur l’histoire et la condition spécifique des femmes noires américaines mais aussi sur l’épistémologie et les enjeux politiques du black feminism, le livre aborde de nombreuses fois la question de la maternité, de la famille et de l’éducation des enfants. Ce sont ces lignes qui m’intéressent plus particulièrement aujourd’hui. Cette note de lecture portera ainsi plus particulièrement sur trois chapitres : « Travail, famille et oppression des femmes noires », « Nounous, matriarches et autres stéréotypes » et « Les femmes noires et la maternité ». Patricia Hill Collins donne une importance à l’autodéfinition et aux savoirs produits par les femmes Africaines-Américaines. A ce titre, son texte est tissé de citations de femmes ce qui en fait un essai politique et sociologique particulièrement fin, sensible et émouvant.
« Travail, famille et oppression des femmes noires »
Dans ce chapitre, l’autrice fait l’histoire des relations « enchevêtrées » (c’est le choix de traduction de la traductrice) des rapports sociaux de genre, de race (puis de classe au cours du XXe siècle) en lien avec les modes de production et la segmentation du marché du travail. Elle s’intéresse dans ce cadre comment ces conditions socio-économiques ont produit certains modèles familiaux et types de maternité spécifiques aux femmes africaines-américaines. La maternité dans « l’idéal familial traditionnel, soit une occupation non rémunérée effectuée à la maison et faisant pendant au travail rémunéré des hommes dans la sphère publique, n’a jamais connu beaucoup de succès auprès de la majorité des Africaines-Américaines » explique-t-elle. En effet, elle montre comment ni l’esclavage, ni le salariat dans les grandes villes par la suite, ne « constituai[ent] le terreau fertile pour l’idée de la maternité comme occupation confinée au cadre de la maison ».
Les « expériences des Africaines américaines comme mère ont été façonnées par les efforts du groupe dominant pour canaliser la sexualité et la fertilité des femmes noires dans un système d’exploitation capitaliste ». En effet, elles s’inscrivent dans une biopolitique de la race qui passe par le contrôle des sexualités et des corps pour maintenir les frontières raciales, mais aussi pour assurer la reproduction de la force de travail. L’autrice rapporte des études sur les efforts des propriétaires d’esclaves pour augmenter la fertilité des femmes et augmenter leurs effectifs d’esclaves, en citant les mots de Deborah Gray White qui parle de « forme passive mais insidieuse d’élevage ». D’autre part, la maternité se voit charger de « transmettre aux enfants le sentiment de ce qu’est leur place dans la société » c’est-à-dire d’apprendre aux enfants à « croire à leur propre infériorité ». Pour autant, la sociologue note aussi que le lien mère – enfant a pu permettre la constitution d’une « sphère privé dans la quelle une culture de la résistance et des formes quotidiennes de résistance peuvent s’apprendre ».
Patricia Hill Collins montre comment les petites filles travaillent, que cela soit dans la sphère domestique ou rémunérée, à la fois comme une participation au travail et comme un apprentissage à celui-ci. Vers 9 ou 10 ans, les filles accompagnent leurs mères au travail ou sont envoyées pour soutenir le travail domestique de proches. Le travail domestique a cette spécificité de pouvoir commencer extrêmement jeune. Elle cite un témoignage dans une étude d’Elizabeth Clark-Lewis : « Il y a pas une seule fille que je connaissais qui avait pas été préparée à travailler à l’extérieur dès l’âge de 10 ans. Vous laviez, surveilliez et battiez quelqu’un dès que vous aviez fini de marcher à quatre pattes ».
La phrase a attiré mon attention alors je suis allé la lire dans sa version originale : « « No girl I know wasn’t trained for work out by ten, » Naomi Yates told me. « You washed, watched, and whipped somebody the day you stopped crawling. Fran the time a girl can stand, she’s being node to work. » Dans ce témoignage, s’exprime aussi une réalité du travail de maternage que je me suis donné pour objectif de traquer dans ma lecture. Le terme traduit par la traductrice par « battre » pourrait aussi être traduit par « fouetter » et fait clairement référence au fait de frapper un autre enfant. Il rappelle la violence du travail reproductif qui se loge au milieu de deux termes plus neutres « laver » et « surveiller ». Notons qu’ici la « domination adulte » est une domination par l’âge, ou « par l’ancienneté » comme la désigne Sébastien Charbonnier3. Notons surtout que cette domination est lié à la question du travail domestique et de l’apprentissage des rôles sociaux.
Le chapitre se termine sur le constat d’une désagrégation de la communauté noire avec l’accession à la classe moyenne de certaines femmes noires et d’une érosion de la prise en charge communautaire des enfants. Elle s’interroge sur une opposition nouvelle entre femmes noires pauvres et femmes noires de classes moyennes. « Vont-elles continuer à valoriser la solidarité noire avec leurs sœurs des classes populaires, même si la création de cette solidarité pourrait les placer en porte-à-faux par rapport à leurs devoirs de type maternaliste ? Vont-elles plutôt, attribuer leurs positions nouvellement acquises à leur seul mérite et ainsi perpétuer la subordination des femmes noires des classes populaires ? »
Cette fin de chapitre saisit les enjeux de classe qui traverse les femmes noires et souhaite par son analyse éviter que certaines femmes noires « jouent un rôle déterminant dans la perpétuation de l’oppression d’autres femmes noires ». Mais, que signifie « maternaliste » ici ? L’autrice désigne les « enseignant·es, chauffeuses d’autobus et de travailleuses sociales qui causent [aux femmes noires pauvres] autant de problèmes que les Blanc·hes qui occupent les mêmes fonctions ». Il y a là peut-être une contradiction qui nous intéresse : des conflits de classe qui s’incarnent autour de conflit éducatif sur le « maternage ».
« Nounous, matriarches et autres stéréotypes »
« Représenter les Africaines-Américaines au moyen des stéréotypes de la nounou, de la matriarche, de l’assistée sociale et de la pute aide à justifier l’oppression des Noires étasuniennes » fait le constat Patricia Hill Collins qui dans ce chapitre va analyser et faire une socio-histoire de ces stéréotypes.
Le stéréotype de la « nounou », « servante obéissante » docile, asexuée, dévouée et intégrée à la famille blanche, sert à « encadrer le comportement maternel des femmes noireés ». Il exprime les « perceptions du groupe dominant quant à la relation idéale des femmes noires avec l’élite du pouvoir mâle et blanc ». Comme tout stéréotype, il sert à produire des normes et des attentes. Intériorisées par les femmes noires, il peut les transformer en « canaux appropriés de la reproduction de l’oppression raciale » en enseignant aux enfants à s’y conformer.
La « matriarche noire » est la « figure de la mère dans la maison des Noir·e·s ». Il s’agit d’une figure de femme forte repoussoir, qui véhicule l’idée que les problèmes sociaux (pauvreté, délinquance) sont les conséquences de mères pas assez féminines, autoritaires, salariées et qui ne peuvent pas bien s’occuper de leurs enfants. Figure trop forte, on les imagine « castratrices » à la fois pour les fils mais aussi pour les amants et les maris. « Présenter les femmes noires comme des mères dangereuses, déviantes, castratrices a divisé la communauté noire à un moment déterminant de la lutte de libération nationale noire. » note par ailleurs l’autrice.
La figure inversée mais complémentaire de celle de la matriarche est celle plus contemporaine de « l’assistée sociale », celle de la mère sans emploi bénéficiant voire « profitant » des allocations familiales. Ce stéréotype renvoie à celui du contrôle de fertilité des femmes « génitrices » sous l’esclavage puisqu’il s’agit ici de brider la fertilité à une époque où la jeunesse noire peu éduquée n’est plus vu comme une main d’oeuvre bon marché, mais comme une « menace coûteuse à la stabilité économique et politique ». « Comme la matriarche, la mère assistée sociale est épinglée comme mauvaise mère », mère qui ne veut pas être « la mule du monde ».
Patricia Hill Collins développe deux autres figures de femmes qui ont comme point commun d’être menaçante par leur absence de maternité : celle de la « black lady » de classe moyenne, dévoué à son travail et qui profiterait des politiques d’action positive et celle de « Jézabel, la putain ou la trainée » qui aurait une sexualité incontrôlable et refuserait la maternité.
« Les femmes noires et la maternité »
Ce chapitre est une tentative de produire « une analyse autodéfinie de la maternité noire ». L’autrice explique en effet que les savoirs blancs sur la maternité noire ont pendant longtemps consisté à accuser les femmes noires « de ne pas réussir à discipliner leurs enfants, d’émasculer leurs fils, de rendre leurs filles peu féministes et nuire aux résultats scolaires de leurs enfants ». Au contraire, les études portées par les hommes noirs ont surtout glorifié la maternité noire en produisant l’archétype normatif de « la mère noire superforte ». « Cependant, remarque Hill Collins, pour se maintenir sur leur piédestal, ces mêmes mères noires superfortes doivent continuer à faire passer leurs besoins après ceux des autres, particulièrement ceux de leurs fils. » Elle va donc construire une autodéfinition de la maternité noire « comme institution est tout à la fois dynamique et dialectique » qui est amenée à évoluer avec le contexte socio-historique.
« Dans les communautés afro-américaines, des frontières mouvantes distinguent les mères biologiques des autres femmes qui prennent soin des enfants, écrit-elle. Les mères biologiques sont censées s’occuper de leurs enfants. Mais les communautés africaines et afro-américaines ont aussi reconnu que faire porter sur une seule personne la responsabilité du maternage n’est pas toujours la solution la plus avisée. Par conséquent, les mères supplétives – les femmes qui aident les mères biologiques en partageant les responsabilités maternelles – ont traditionnellement été centrales dans l’institution de la maternité noire ».
Elle souligne tout à la fois des continuités culturelles avec les cultures africaines, et une adaptation aux nécessités des conditions de vie des femmes noires aux États-Unis. Elle montre comment les parentèles vont tendre à se construire autour des femmes, dans des réseaux d’entraide entre femmes, qu’elles soient liées biologiquement ou non (parentes, amies, voisines…). Elle fait le lien avec la notion de « parent d’emprunt » qui désigne des formes courantes d’adoption et de prise en charge d’enfants non-biologiques. Ces formes de « parenté sociale » permettent aussi aux communautés de prendre en charge les enfants quand la mère biologique ne peut s’en occuper. Ce qui arrive régulièrement dans un contexte d’oppressions enchevêtrées : enfant orphelin d’une mère esclavagisée vendue, enfant né d’un viol, mère en prison ou droguée, mère dans l’extrême pauvreté…
Elle souligne encore une fois comme la maternité supplétive est le fruit d’un apprentissage pour les petites filles. Elle cite les mots d’un témoignage d’une jeune fille qui prend « soin » des enfants d’un voisin veuf : « Les enfants étaient turbulents […] Les enfants […] se sauvaient à travers champs. Nous les pourchassions, les ramenions à la maison, les mettions dans le bain, les lavions, changions leurs vêtements, rapportions les vêtements sales à la maison, les lavions. » Dans les mots du « soin », se loge un lexique de la domination : « nous les pourchassions ».
« Dans ce contexte, les Africaines-Américaines qui pratiquent le gardiennage communautaire des enfants remettent en cause un présupposé fondamental du système capitaliste : les enfants constituent une « propriété privée » et doivent être traités comme tels. Selon le modèle de la propriété qui accompagne l’idéal familial traditionnel, les parents peuvent ne pas dire que leurs enfants sont leur propriété, mais leur façon de les élever reflète des présupposés similaires à ceux qui régissent la propriété. Par exemple, le « droit » parental exclusif de faire obéir les enfants à sa convenance, même si cela frise l’abus, concorde parfaitement avec le présupposé voulant que les propriétaires peuvent disposer de leur propriété sans consulter les autres membres de la collectivité. »
A cause de la désagrégation raciale de la communauté noire en lien avec les plus grandes inégalités sociales en son sein, mais aussi à cause du crack dans la décomposition sociale des communautés noires, la sociologue voit le modèle des mères supplétives décroître dans les années 80. Cependant, même si « l’augmentation des mauvais traitements et de la négligence a laissé plusieurs enfants sans soin », elle souligne la résistance et la résilience de ces modèles de prise en charge communautaire des enfants. « Dans ce contexte, les Africaines-Américaines qui pratiquent le gardiennage communautaire des enfants remettent en cause un présupposé fondamental du système capitaliste : les enfants constituent une « propriété privée » et doivent être traités comme tels, analyse-t-elle. Selon le modèle de la propriété qui accompagne l’idéal familial traditionnel, les parents peuvent ne pas dire que leurs enfants sont leur propriété, mais leur façon de les élever reflète des présupposés similaires à ceux qui régissent la propriété. Par exemple, le « droit » parental exclusif de faire obéir les enfants à sa convenance, même si cela frise l’abus, concorde parfaitement avec le présupposé voulant que les propriétaires peuvent disposer de leur propriété sans consulter les autres membres de la collectivité. » Dans ces lignes, la sociologue donne un élément pour comprendre la domination des adultes sur les enfants. Toutefois, son propos est trop rapide pour qu’on puisse en déduire une moins grande oppression des enfants dans un contexte de prise en charge communautaire des enfants. Cependant, elle fait aussi de ce modèle un modèle de résistance et de solidarité. Dans la suite du chapitre, elle prolonge d’ailleurs en s’interrogeant sur les possibilités militantes de la « maternité supplétive ». Elle souligne que cela implique une éthique de la responsabilité qui permet de comprendre l’engagement politique des femmes noires et le parcours de beaucoup de militantes. « Le maternage communautaire sert la communauté noire en manifestant une éthique de la sollicitude et de la responsabilité personnelle. Un tel pouvoir est transformateur parce que les rapports des femmes noires avec leurs enfants et avec les autres membres de la communauté qui sont vulnérables ne visent pas à les dominer ni à les contrôler. Leur objectif est plutôt de rassembler les gens [… pour leur permettre] d’accéder à l’autonomie et à l’indépendance essentielles à leur résistance ».
« Le maternage communautaire sert la communauté noire en manifestant une éthique de la sollicitude et de la responsabilité personnelle. Un tel pouvoir est transformateur parce que les rapports des femmes noires avec leurs enfants et avec les autres membres de la communauté qui sont vulnérables ne visent pas à les dominer ni à les contrôler. Leur objectif est plutôt de rassembler les gens [… pour leur permettre] d’accéder à l’autonomie et à l’indépendance essentielles à leur résistance »
Effectivement, la maternité des femmes noires est tiraillée entre plusieurs enjeux, dont l’un est celui de la libération. Dans de très belles lignes, elle explore le « dilemme » que ressente les mères noires avec leurs filles. Il s’agit pour elle d’assurer leur survie physique et donc leur intégration dans la « politique sexuelle de la féminité noire » (c’est-à-dire les inciter à être des « nounous ») et travailler intensément pour pouvoir les nourrir. En même temps, elle souhaite aussi leur donner la confiance en soi, les capacités d’autodéfinition pour permettre de résister à l’oppression. Elle note un « pragmatisme visionnaire » des mères noires qui luttent à la fois pour la survie de leur enfant et pour les pousser à aller plus loin qu’elles mêmes. Ce savoir-faire pédagogique, entre libération et subsistance, s’ancre dans la capacité qu’ont toujours eu les femmes noires à « conjuguer autonomie économique et maternité ». « Le travail, note-t-elle, a constitué une composante importante et valorisée de la maternité [noire] ». En outre, le contact avec les blancs dans le cadre du travail de domesticité donne à ses femmes beaucoup de connaissances tout à la fois sur les meilleurs moyens pour permettre l’ascension sociale de leurs enfants mais aussi des dangers qui attendent leurs filles.
Ce double enjeu permet d’expliquer des contradictions apparentes dans les relations mères filles. « Les mères noires aux Etats-Unis sont souvent décrites comme étant très strictes et surprotectrices ; pourtant, ces mêmes femmes réussissent à élever des filles autonomes et sûres d’elles. » Elles donnent ainsi souvent une importance à la protection soit « en essayant de protéger leurs filles le plus longtemps possible des inconvénients liés à leur statut méprisé, soit en leur enseignant des habitus d’indépendance et d’autonomie qui leur permettront de se protéger elles-mêmes. »
La difficulté de la tâche des mères noires peut tendre les relations émotionnelles entre mères et filles, qui doivent négocier avec les représentations dominantes de l’amour maternelle. « Pour trop de mères noires, prendre soin des enfants dans un contexte d’oppressions enchevêtrées était si exigeant qu’elles n’avaient pas le temps pour la patience ou la tendresse, explique-t-elle. […] Pour une fille, grandir signifie développer une meilleure compréhension du fait que même si on peut désigner plus de tendresse et de liberté, les soins physiques et la protection prodigués par sa mère sont des gestes d’amour maternel. » Ces gestes d’amour peuvent être toutefois aussi pris en charge par les mères supplétives qu’elles soient tantes, voisines ou enseignantes, des femmes qui femmes qui « n’avaient pas à me faire vivre, et par conséquent avaient le loisir de me faire parler » (Weems).
illustration : Arthur Rothstein, « Girl at Gee’s Bend, Alabama« , 1937, Collection of the Smithsonian National Museum of African American History and Culture
- Voir l’ouvrage collectif Politiser l’enfance aux éditions Burn Août (2023) ou Enfantisme de Claire Bourdille (2025). ↩︎
- Elsa Galerand et Danièle Kergoat. « Consubstantialité vs intersectionnalité? À propos de l’imbrication des rapports sociaux. » Nouvelles pratiques sociales, volume 26, numéro 2, printemps 2014 ↩︎
- Sébastien Charbonnier, La Fabrique de l’enfance, lundimatin, 2025 ↩︎

