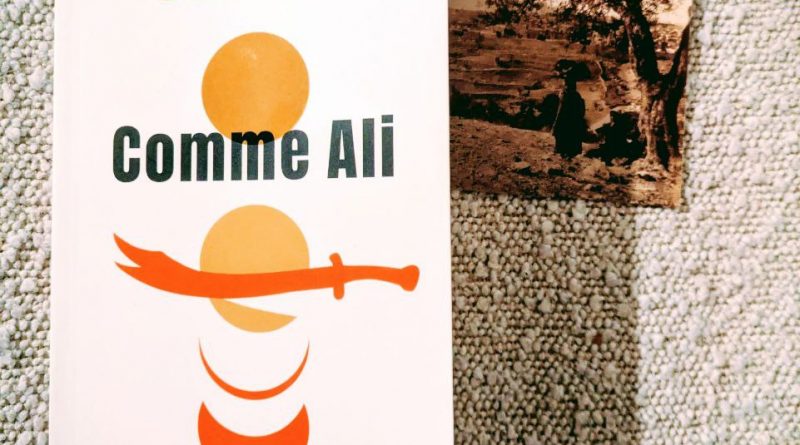Comme Ali, les rêves du « garçon arabe »
La camarade Fatima Ouassak signe dans la collection Nouvelles Lunes au éditions Au Diable Vauvert un petit roman intitulé Comme Ali. Il s’agit du récit, réalisé à la première personne par Ali, un garçon de neuf ans, de la journée et de la soirée ayant suivi le meurtre de Nahel Merzouk par des policiers le 27 juin. L’enfant raconte comment l’information du meurtre de Nahel s’est propagée à la cantine. Puis comment, avec ses parents et ses voisins, iels sont descendu·es regarder le commissariat brûler en bas de chez elleux. Et enfin, comment il a terminé la destruction de ce dernier et combattu les policiers à l’aide d’un djinn et de la mythique épée Zulfikar.
Récit politique et existentiel
Le roman traverse des thématiques chères à Fatima Ouassak, déjà explorées dans ses précédents essais. On y retrouve une critique acerbe de l’école, de ses règles absurdes et de son racisme, la « désenfantisation » des minots racisés (La puissance des mères), une critique écologiste de la bétonisation des quartiers populaires et bien entendu une dénonciation sans concession des crimes policiers (Pour une écologie pirate). Toutefois, Comme Ali prolonge davantage le projet littéraire que l’autrice commence dans Rue du passage, à savoir la productions d’un nouvel imaginaire de l’enfance, fidèle à l’expérience des enfants racisés de quartiers populaires. Cependant, si la Rue du passage explore dans sa quotidienneté les douceurs et les heurts de la vie familiale immigrée, Comme Ali chronique l’événement, son intensité et sa violence. Le livre retrace la fascination morbide pour les vidéos du meurtre et le sentiment de révolte contre l’injustice même chez les plus jeunes (« à l’unanimité du réfectoire, nous en avons compris que le policier voulait se faire un arabe. Faut dire que tout ce qui peut couvrir le meurtre d’Arabe peut tromper bien des gens, mais pas les Arabes de la cantine« ). Le récit s’y fait métaphysique et existentiel, parce que l’écriture est hantée par la mort (celle du Nahel, celles de tous les autres enfants aux « visages d’ange […] traqués et tués d’une manière ou d’une autre par les hommes sans visage du commissariat ») et tissée de références religieuses.
Geste littéraire décolonial et défi à l’islamophobie
Il n’y a pas d’épée comme Zulfikar, Il n’y a pas d’héro comme Ali
En effet, nul blanchiment littéraire de l’enfance ici : le petit Ali a reçu une éducation islamique qu’il mobilise face à l’image de la mort (« moi j’ai avancé que s’il [Nahel] était conscient de quitter ce monde, alors il a récit la shahada ») et dans ses rêves de justice et de vengeance (« Il n’y a pas d’épée comme Zulfikar, Il n’y a pas d’héro comme Ali »). Fatima Ouassak raconte des histoires que le lecteur non-musulman que je suis ne connaît pas. Elle nourrit son jeune héros d’un imaginaire islamique, qui lui permet de résoudre les énigmes du djinn, l’aiguille dans sa quête de justice et l’arme de courage. L’autrice met dans les mains du petit Ali le mythique Zulfikar, sabre de Ali, le cousin du prophète. Pourquoi l’autrice construit-elle cette figure du Garçon Arabe Musulman menaçant ? Pourquoi convoque-t-elle l’imaginaire guerrier de l’islam ?
« Oui, certains parlent de colombe plutôt que de pigeon, mais ce sont les mêmes qui parlent de souris plutôt que de rat, explique Ali au djinn dans un dialogue qui permet à l’autrice d’expliciter un projet littéraire décolonial. Ils déclinent au féminin les animaux qu’ils considèrent comme dangereux sous prétexte de les rendre plus beaux, alors qu’ils ne cherchent qu’à les rendre plus inoffensifs. Moi je préfère parler de pigeon, comme je préfère parler de rat, et je ne suis pas un enfant, je suis un garçon. […] Debout au sommet de la ville, moi je n’étais pas un enfant. J’étais Arabe. Et les Arabes ne sont jamais des enfants. »
Dans un geste de défi à l’islamophobie ambiante, Comme Ali refuse de nier la force de ce que le religieux transmet aux enfants. En tant que mère dans La Puissance des mères, et cette fois-ci en tant qu’autrice, elle refuse le rôle de « rendre plus inoffensif » les enfants des quartiers populaires. Toutefois, à travers l’écriture, c’est aussi le conte mais aussi – si on connaît Fatima Ouassak – les mangas qui viennent aussi nourrir la révolte. De roman social le roman se transforme en effet progressivement en conte, en prière, puis en scène de combat virevoltante digne des meilleurs animés. « Les flammes ont formé une énorme pelote. Je l’ai dirigée vers les quarante policiers en criant Dragons de feu » [aka « Kamé Hamé Ha »).
Que de tendresse pour nos enfants
Sous sa botte et pour l’éternité, coulent le miel et le lait.
Si le livre ne veut pas rassurer face au « garçon arabe » (celui dont parle Nacira Guénif-Souilamas et Eric Macé parlait dès 2004 dans Les féministes et le garçon arabe1), l’autrice écrit cependant son personnage avec une grande tendresse et subtilité ; un enfant traversé d’une multiplicité d’expériences, de sentiments et d’influences (notons par exemple la soif de liberté qui s’exprime dans la passion pour le jeu-vidéo Zelda et la connivence entre le père et son fils à son sujet ou encore son intérêt pour les marques de voiture et de vêtements). Dans son âme, dans sa vie et dans sa chaire, Ali a un grand réalisme et le personnage littéraire provoque une vraie sensation de familiarité.
A la lecture, j’y ai retrouvé les affects de mes élèves de CM2 lors de ce mois de juin 2023 qui s’identifiaient pleinement aux jeunes révolté·es. « Maître, tant qu’il n’y aura pas de justice, on continuera ! » m’expliquait B., un de mes élèves, alors que le quartier de l’école avait brûlé toute la nuit. Celui la même avait envoyé à l’adjointe au maire venue distribuer des dictionnaires : « Vous allez faire quoi pour Nahel ? Vous allez faire quoi pour l’école ? ». B. n’allait pas réellement dans la rue affronter la police durant les chaudes nuits de ce mois de juin 2023.
Toutefois, probablement comme le petit Ali du roman, B. rêvait la nuit de justicier qui terrassait la police.
Merci à Fatima Ouassak de faire exister, avec l’âpreté et leur violence, nos enfants et leurs rêves de justice.
Fatima Ouassak, Comme Ali, Au Diable Vauvert, 96 pages, mars 2025, 12€
- Précurseur à bien des égards, le livre montre comment un certain féminisme blanc hégémonique a participé à construire la figure raciste du « garçon arabe » essentiellement violent et misogyne. ↩︎